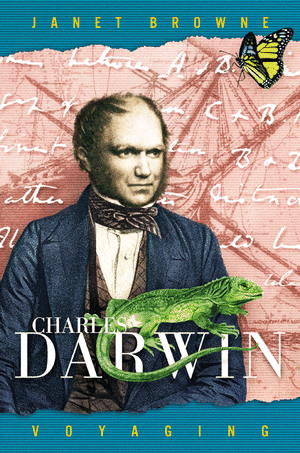Avec l'ouverture au public de la Caverne du Pont d'Arc, l'intérêt pour les grottes ornées du Paléolithique connaît un certain regain. C'est l'occasion de voir sortir, ou ressortir, quelques livres sur ces sujets. Je ne me plaindrai pas que l'archéologie préhistorique bénéficie d'un peu de médiatisation.
Ainsi, un très bel album de photographies, avec un texte de Jean Clottes, publié il y a deux ans par le Dauphiné Libéré (c'est annoncé dès les premières lignes), a les honneurs d'une nouvelle publication très soignée par Actes Sud, sous le titre "La grotte du Pont d'Arc dite grotte Chauvet - Sanctuaire préhistorique". Le prix très raisonnable (25€) permettra à ceux qui ne peuvent pas se rendre en Ardèche de satisfaire leur curiosité sans se ruiner (et à ceux qui auront visité le site, de garder un très beau souvenir).
Le préhistorien nous explique l'essentiel dans ce livre : à quelle époque ont été réalisées peintures et gravures dans cette grotte ; par qui ; dans quel contexte environnemental. Il raconte aussi la découverte de la grotte, fin 1994, en évitant soigneusement les controverses, toujours pas réglées (elles mériteraient peut-être un autre livre, mais parasiteraient inutilement celui-ci). Et il donne assez d'éléments pour que l'on puisse se faire une idée du type de travaux scientifiques menés dans le site.
Bien entendu, une bonne place est accordée aux peintures et aux gravures. Les photographies sur de pleines pages, voire des doubles pages, avec différents niveaux de détail, sont le clou du livre. On ne se lasse pas de les regarder, d'autant qu'elles sont reproduites avec une très bonne qualité. L'idée de terminer en braquant l'attention sur quelques espèces représentées, sur lesquelles le lecteur aurait pu ne pas s'arrêter, est aussi excellente. On en aurait presque voulu plus!
Je n'ai qu'une réserve, à propos des dix pages du livre consacrées aux motivations des préhistoriques pour réaliser de telles peintures et gravures. Jean Clottes y présente en effet son scénario "chamanique" comme l'hypothèse "qui rend le mieux compte des faits établis, non seulement par les observations de terrain et par les découvertes récentes, mais également en prenant en compte ce que l'on sait des modes de pensée dans les sociétés traditionnelles". Cette opinion, présentée de façon si catégorique, n'est en fait pas partagée, c'est le moins que l'on puisse dire, par l'immense majorité des préhistoriens actuels.
lundi 12 octobre 2015
mardi 22 septembre 2015
Un gros pavé pour rien
Un mois presque depuis le dernier post
sur ce blog. C'est long. Mais long, Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari, que les éditions Albin Michel viennent de traduire en
français, l'est aussi : 492 pages.
Et assez ennuyeux.
Quel
intérêt des lecteurs, en Israël d'abord, puis aux
Etats-Unis et ailleurs (le livre a été traduit en une trentaine de langues, nous dit l'éditeur), ont-ils trouvé à ce livre? Quel intérêt les lecteurs
français y trouveront-ils? J'ai du mal à le dire.
Yuval Noah Harari manie bien la
rhétorique, c'est certain. Il est habile à faire des rapprochements
provocateurs. Mais il ne mène nulle part. Si vous êtes
vraiment curieux de ce qu'il a à dire, et que vous avez un gros
quart d'heure disponible, visionnez sur le Web la conférence Ted qu'il a donnée à Londres en juin 2015. Mais ne perdez pas plus
votre temps.
Sapiens
prétend, comme l'explicite son sous-titre, nous raconter l'histoire
de l'homme, et nous expliquer pourquoi notre espèce est parvenue à
dominer la planète. Le propos est ambitieux. On suppose qu'il se
fonde sur une documentation abondante et bien vérifiée. On a tort.
L'auteur commence,
en toute logique, par l'apparition de notre espèce et par les
quelques centaines de milliers d'années de la préhistoire.
Malheureusement, il n'a pas pris la
peine de comprendre précisément ce dont il parle. Ainsi dès la
page 15, peut-on lire : « Il y a six millions d'années, une
même femelle eut deux filles : l'une qui est l'ancêtre de tous les
chimpanzés ; l'autre qui est notre grand-mère ». On peut
passer sur la datation, qui est un peu plus récente que ce que les
biologistes et les paléontologues acceptent aujourd'hui. Mais sa
vision de la spéciation est confondante.
Deux
pages plus loin, il invente carrément une espèce : « L'analyse
génétique prouva que le doigt était celui d'une espèce humaine
encore inconnue, qu'on a baptisée du nom d'Homo
denisova. » Si quelqu'un a
la référence du certificat de baptême de cette espèce, je suis
preneur. Et pour continuer sur les « hommes de Denisova »
(comme les appellent plus prudemment les paléoanthropologues), il
invente encore, page 30, pour appuyer sa vision hégémonique d'Homo
sapiens : « Qu'il faille
ou non les en blâmer, les Sapiens n'étaient pas plutôt arrivés
quelque part que la population indigène s'éteignait [...] L'Homo
denisova disparut [...] Il y a
quelques 40 000 ans. ». Rappelons que cette population n'est
connue que par deux fragments osseux et une dent, provenant du même
site et pas très bien datés, aux alentours de 50 000 ans. On ne sait ni quand elle s'est formée, ni quand elle aurait "disparu". En outre,
elle a laissé une part non négligeable de ses gènes aux hommes
actuels.
Pour
Yuval Noah Harari, d'ailleurs, l'espèce Homo sapiens
n'apparaît réellement qu'il y a 70 000 ans. Avant, il ne s'agit pas
vraiment d'hommes comme nous. Chez ces « hommes archaïques »,
précise-t-il page 46, « Pour autant qu'on puisse le dire, les
changements de structures sociales, l'invention de nouvelles
techniques et le peuplement d'habitats étrangers résultèrent des
mutations génétiques et de pressions du milieu, plus que
d'initiatives culturelles ». Et encore page 48, « Bien
incapables de composer des fictions, les Neandertal étaient
incapables de coopérer effectivement en grands nombres ; ils ne
pouvaient adapter leur comportement social à des défis qui se
renouvelaient rapidement. » Là aussi, je serais curieux de
connaître les données objectives qui fondent de telles affirmation
(en revanche, je connaît quelques données objectives qui témoignent
plutôt du contraire).
Rassurez-vous, je
ne vais pas continuer sur le même mode. L'espace ne coûte rien sur
un blog, mais je sais que le temps de mes lecteurs est compté. Je
pourrais presque faire un post par jour pendant plusieurs mois à
partir de toutes les approximations et les erreurs que contient ce
livre.
C'est que la
démarche est biaisée : l'auteur a eu une idée pour expliquer
l'histoire humaine, et il a ensuite recherché les arguments pour
l'étayer. Outre qu'il n'en a pas réellement trouvé, ce qui l'oblige à tordre les faits en sa faveur, son idée
n'explique en fait pas grand chose. Le cœur de son propos est en
effet l'affirmation que toutes les sociétés, cultures et
institutions humaines sont des fictions créées par nous mêmes. Et
alors?
Habilement, il
raconte des histoires amusantes : il démontre que la société
Peugeot n'existe pas vraiment, que le droit est une religion, et le
capitalisme une croyance. Peut-être réussit-il ainsi à « choquer
le bourgeois ». Mais il fait surtout penser à l'abbé de
Villecourt, dans le film « Ridicule » de Patrice Leconte,
qui, après avoir démontré magistralement l'existence de Dieu
conclue « mais j'aurais tout aussi bien pu démontrer le
contraire! ». Heureusement pour Yuval Noah Harari, il ne risque
pas l'exil.
Le témoignage
peut-être le plus flagrant de son manque de pertinence apparaît
sans doute à la page 129 quand il écrit, à propos de ce qui est
censé être son domaine de spécialité : « L'histoire est une
chose que fort peu de gens ont faite pendant que tous les autres
labouraient les champs et portaient des seaux d'eau ». J'ajouterais, à le lire, que ce "fort peu de gens" qui auraient fait l'histoire selon lui sont surtout occidentaux, et mâles. C'est peut-être ce qui rassure ses lecteurs.
dimanche 23 août 2015
Polar psycholinguistique
L'auteur, adepte de la caricature
acerbe, dépeint avec cruauté le petit monde professoral
exclusivement masculin de cet institut qui étudie les acquisitions
langagières des tout petits. Au mieux, ces chercheurs ne
s'intéressent qu'à eux-mêmes, à leur notoriété et à leurs
conquêtes féminines. Au pire, ils médisent les uns sur les autres
et se détestent. Les rôles féminins ne sont tenus que par des
puéricultrices de la crèche installée sur place, qui fournit un
champ d'observations et d'expérimentations aux chercheurs, et par
quelques étudiantes, prêtes à rendre les armes devant les virils
professeurs.
L'enquête menée du point de vue l'un
des chercheurs, le principal suspect aux yeux du policier
officiellement en charge de celle-ci (mais qui fait finalement figure
de comparse), a un petit côté Hercule Poirot ou Miss Marple. Une
liste de suspects connue, un univers clôt, quelques rebondissements,
des fausses pistes... David Carkeet a sans doute beaucoup lu Agatha
Christie dans sa jeunesse. Ce n'est pas déplaisant.
La psycholinguistique présentée dans
ce livre est toutefois un peu datée : la traduction date de 2013,
mais l'original est paru aux Etats-Unis en 1980. A l'époque
numérique, nul doute que Jeremy Cook n'aurait pas seulement
enregistré le petit Wally (sur un magnétophone à bande!), mais
qu'il l'aurait aussi filmé. Et la machine à écrire, qui tient un
petit rôle dans l'intrigue, a disparu depuis bien longtemps de tous
les centres de recherche.
La date de publication initiale m'a
d'ailleurs conduit à une interrogation, pour l'instant sans réponse
(au contraire de toutes celles énoncées au début de cette note).
Afin d'effrayer le coupable, démasqué par une méthode linguistique
que je ne trahirai pas, le policier lui indique que l'on a retrouvé
des traces de son ADN sur l'une des victimes. Or, en 1980, on était
encore loin de séquencer l'ADN à des fins judiciaires. L'auteur
a-t-il voulu montrer ses connaissances scientifiques, au risque
d'anticiper (en 1980, Walter Gilbert et Frederik Sanger ont partagé
la moitié du prix Nobel de chimie pour leurs travaux sur, justement,
le séquençage de l'ADN)? Ou le traducteur français a-t-il fait du
zèle et introduit un anachronisme? Si quelqu'un connaît la réponse,
je le remercie par avance.
lundi 17 août 2015
Science en famille
On savait que Marie Curie avait fait
de la science en famille : avec son mari, Pierre, puis avec sa fille
Irène. Ses petits enfants, qui l'ont à peine connue, et même l'un
de ses arrière-petit-fils ont suivi la même voie. Mais aurait-elle
fait de la science si elle n'avait pas eu sa famille, et notamment sa
sœur aînée Bronia? Rien n'est moins sûr, raconte Natacha Henry
dans Les sœurs savantes (La Librairie Vuibert, 2015, 288 p., 19,90 €).
Marie Curie (ou plutôt, Sklodowska,
de son nom de naissance), rappelle ainsi Natacha Henry, partageait
avec Bronia l'idéal familial d'un accès des femmes aux études et
au savoir. Cet idéal était pour le moins contrarié dans la Pologne
sous domination russe de la fin du XIXe siècle où elles vivaient.
Après une formation initiale dans une « université volante »
clandestine, où des enseignants bénévoles et engagés dispensaient
des cours aux jeunes filles, il fallait partir de Varsovie. C'est
Bronia qui, la première, vint à Paris, suivre des études de
médecine, soutenue par l'aide financière de sa cadette, qui
travaillait comme gouvernante. C'est Bronia qui, la première,
soutient une thèse, en médecine (sur l'allaitement maternel).
C'est aussi Bronia qui, la première,
se maria. En 1891, elle épousa un médecin, Casimir Dluski. Ce
dernier était polonais, et surtout c'était un activiste politique.
Ensemble, ils repartirent en Pologne, près de Zakopane, dans la
partie alors sous domination austro-hongroise, pour fonder un
sanatorium. Ce sanatorium, ouvert en 1902, accueillit nombre de
célébrités, et devint même en partie un centre de réflexion
nationaliste polonais avant la Première guerre mondiale. En 1918, la
Pologne devenue indépendante, Dluski participa à la délégation
polonaise dans la négociation du traité de Versailles.
Le rôle de Bronia dans la
trajectoire de Marie Curie est fortement valorisé par Natacha Henry.
Selon cette dernière, l'aînée ne s'est pas contentée d'être un
modèle à suivre. C'est en effet Bronia qui argumenta auprès d'une
Marie démoralisée par un chagrin d'amour, pour qu'elle vienne comme
prévu suivre des études à Paris. C'est elle qui l'hébergea dans
son petit appartement de jeune mariée lorsqu'elle arriva enfin dans
la capitale française. C'est elle encore qui lui fit rencontrer des
intellectuels polonais en exil et entretint ses convictions patriotiques, humanistes et de gauche.
D'autres aspects de la vie de Marie
Curie racontés dans ce livre sont plus connus : sa rencontre avec
Pierre Curie, le décès prématuré de celui-ci, les deux prix
Nobel, la liaison avec Paul Langevin, la fondation de l'institut du
radium, les tournées américaines, etc. La cible très grand public
nécessitait évidemment de les rappeler. Mais nombre d'éléments
sont aussi là pour dessiner un parallèle avec les engagements de
Bronia, à Paris et en Pologne. Ces deux femmes ne partageait pas que
l'amour de la science : elles avaient toutes les deux une conscience
forte de leurs responsabilités sociales et politiques.
Est-ce par peur d'effrayer des
lecteurs que la science de Marie Curie est si peu présente dans
l'ouvrage? La seule exception est à la page 103. Et encore, la
formulation est-elle erronée (l'uranium n'émet pas de lumière
mais, justement de la radioactivité, invisible à nos yeux). C'est
un peu dommage.
Dans le genre « biographie
empathique », dans lequel l'auteur se place en permanence du
point de vue de ses personnages, l'ensemble est assez réussi.
Evidemment, Natacha Henry finit par manquer un peu de distance
vis-à-vis de son sujet. Mais il est difficile d'être critique en ce
qui concerne Marie Curie, femme remarquable, scientifique
exceptionnelle, citoyenne engagée. Son statut de « sainte
laïque », officialisé par le transfert de ses cendres au
Panthéon en 1981, n'est pas près de lui être disputé.
vendredi 24 juillet 2015
A Paris, sur la piste des grands singes
Je suis enfin allé à la Grande Galerie du Muséum national d'histoire naturelle pour visiter l'exposition Sur la piste des grands singes, présentée depuis le 11 février. J'avais encore le temps : elle ne devrait pas fermer avant le 21 mars prochain. Et j'ai une excuse : la dernière fois que j'ai voulu y aller, c'était un mardi, et c'est jour de fermeture du Muséum (pensez-y).
Bien sûr, vous direz que ce blog est consacré aux livres (et un peu à des films), et qu'une critique d'exposition n'a rien à y faire. Vous aurez raison. Mais si on ne peut plus faire des exceptions, à quoi bon tenir un blog? Et puis quelqu'un à qui je ne peux pas refuser grand chose m'a demandé mon avis sur cette exposition, alors autant en faire profiter le plus grand nombre (je ne me fais pas d'illusions non plus sur la taille de mon lectorat).
Evidemment, j'ai aussi pensé poster cette note sur mon blog consacré aux hommes du passé. En tirant fortement le gorille, le chimpanzé et l'orang-outang par les poils, j'aurais pu argumenter sur la présence dans cette exposition de quelques fossiles de primates anciens, et même des premiers hominidés. Mais décidément, celle-ci est bien consacrée aux grands singes actuels (les trois catégories que je viens de citer), et leur passé n'est là que pour éclairer leurs relations évolutives.
Ces questions d'évolution, notamment les relations biologiques qui nous lient à ces plus proches parents, sont assez rapidement réglées au début de l'exposition. C'est à peine si notre statut de grand singe africain est évoqué, et il n'est pas question de la plus grande proximité avec, dans l'ordre, les chimpanzés, les gorilles, et seulement ensuite les orangs-outans.
Car ce n'est pas ce qui intéresse les concepteurs de cette exposition. D'ailleurs, les présentations mêlent allègrement les trois espèces (en fait, les cinq, puisqu'on distingue deux espèces de chimpanzés et deux espèces d'orang-outans). Il s'agit plus d'insister sur leurs ressemblances que sur leurs différences. Ainsi, ces animaux vivent globalement dans "la forêt tropicale", sans que soient détaillées les différences entre celle du Gabon et celle de Bornéo par exemple.
En marchant notamment dans un espace censé figurer cette forêt tropicale (rassurez-vous, cela reste très passant), on découvre tour à tour la locomotion, la vie sociale, l'alimentation (non, les chimpanzés ne mangent ni bananes ni arachides dans leur milieu naturel), les comportement sexuels (préparez-vous aux questions si vous amenez des enfants encore naïfs), les habitats (ces singes construisent des nids), la culture, et plein d'autres choses à propos de ces espèces. La muséographie est bien pensée, avec une association de films tournant en boucle, d'autres accessibles avec un casque, mais aussi d'animations informatiques interactives. Même si on peut regretter que, comme d'habitude, certaines explications écrites soient illisibles, il y en a assez peu pour que le visiteur, même acharné à tout voir, ne soit pas trop frustré.
L'exposition se termine sur les menaces que subissent ces grands singes, surtout liées à l'action de l'homme. Je n'ai aucun doute sur les intentions des concepteurs : ils souhaitent sensibiliser sur l'importance de préserver les habitats, et les animaux eux-mêmes. Mais l'ampleur des menaces que constitue notre société moderne, figurées par un immense panneau où toutes sortes d'objets "nocifs" sont accumulés, est assez décourageante. D'autant que de petits films très bien réalisés en stop-motion viennent appuyer la démonstration. Aucune catégorie de produits n'est épargnée.
Face à cela, les solutions proposées, qui se limitent à un appel à une consommation responsable (faire durer les produits, recycler, ne pas gaspiller...) semblent bien faibles. Est-ce parce que l'exposition s'adresserait prioritairement à un jeune public? Heureusement, les tous derniers espaces d'exposition sont consacrés à des actions de terrain, d'ONG principalement. Mais aucune proposition n'est faite pour les soutenir. Et l'on sait bien que l'appui au développement durable des pays où vivent encore des grands singes passe par des actions politiques. Le Muséum aurait pu assumer sa vision écologique jusqu'au bout.
Souhaitons quand même que, parmi les nombreux enfants et adolescents qui visiteront cette exposition (enseignants, vous avez encore le temps d'organiser cela pour vos classes en 2015-2016!), certains en ressortiront assez inspirés pour se mettre à l'action à différents niveaux. J'avoue qu'entendre une fillette d'une dizaine d'années dire à sa mère, devant un dispositif de l'exposition : "c'est intéressant comme métier, paléontologue", m'a particulièrement réjoui.
Bien sûr, vous direz que ce blog est consacré aux livres (et un peu à des films), et qu'une critique d'exposition n'a rien à y faire. Vous aurez raison. Mais si on ne peut plus faire des exceptions, à quoi bon tenir un blog? Et puis quelqu'un à qui je ne peux pas refuser grand chose m'a demandé mon avis sur cette exposition, alors autant en faire profiter le plus grand nombre (je ne me fais pas d'illusions non plus sur la taille de mon lectorat).
Evidemment, j'ai aussi pensé poster cette note sur mon blog consacré aux hommes du passé. En tirant fortement le gorille, le chimpanzé et l'orang-outang par les poils, j'aurais pu argumenter sur la présence dans cette exposition de quelques fossiles de primates anciens, et même des premiers hominidés. Mais décidément, celle-ci est bien consacrée aux grands singes actuels (les trois catégories que je viens de citer), et leur passé n'est là que pour éclairer leurs relations évolutives.
Ces questions d'évolution, notamment les relations biologiques qui nous lient à ces plus proches parents, sont assez rapidement réglées au début de l'exposition. C'est à peine si notre statut de grand singe africain est évoqué, et il n'est pas question de la plus grande proximité avec, dans l'ordre, les chimpanzés, les gorilles, et seulement ensuite les orangs-outans.
Car ce n'est pas ce qui intéresse les concepteurs de cette exposition. D'ailleurs, les présentations mêlent allègrement les trois espèces (en fait, les cinq, puisqu'on distingue deux espèces de chimpanzés et deux espèces d'orang-outans). Il s'agit plus d'insister sur leurs ressemblances que sur leurs différences. Ainsi, ces animaux vivent globalement dans "la forêt tropicale", sans que soient détaillées les différences entre celle du Gabon et celle de Bornéo par exemple.
En marchant notamment dans un espace censé figurer cette forêt tropicale (rassurez-vous, cela reste très passant), on découvre tour à tour la locomotion, la vie sociale, l'alimentation (non, les chimpanzés ne mangent ni bananes ni arachides dans leur milieu naturel), les comportement sexuels (préparez-vous aux questions si vous amenez des enfants encore naïfs), les habitats (ces singes construisent des nids), la culture, et plein d'autres choses à propos de ces espèces. La muséographie est bien pensée, avec une association de films tournant en boucle, d'autres accessibles avec un casque, mais aussi d'animations informatiques interactives. Même si on peut regretter que, comme d'habitude, certaines explications écrites soient illisibles, il y en a assez peu pour que le visiteur, même acharné à tout voir, ne soit pas trop frustré.
L'exposition se termine sur les menaces que subissent ces grands singes, surtout liées à l'action de l'homme. Je n'ai aucun doute sur les intentions des concepteurs : ils souhaitent sensibiliser sur l'importance de préserver les habitats, et les animaux eux-mêmes. Mais l'ampleur des menaces que constitue notre société moderne, figurées par un immense panneau où toutes sortes d'objets "nocifs" sont accumulés, est assez décourageante. D'autant que de petits films très bien réalisés en stop-motion viennent appuyer la démonstration. Aucune catégorie de produits n'est épargnée.
Face à cela, les solutions proposées, qui se limitent à un appel à une consommation responsable (faire durer les produits, recycler, ne pas gaspiller...) semblent bien faibles. Est-ce parce que l'exposition s'adresserait prioritairement à un jeune public? Heureusement, les tous derniers espaces d'exposition sont consacrés à des actions de terrain, d'ONG principalement. Mais aucune proposition n'est faite pour les soutenir. Et l'on sait bien que l'appui au développement durable des pays où vivent encore des grands singes passe par des actions politiques. Le Muséum aurait pu assumer sa vision écologique jusqu'au bout.
Souhaitons quand même que, parmi les nombreux enfants et adolescents qui visiteront cette exposition (enseignants, vous avez encore le temps d'organiser cela pour vos classes en 2015-2016!), certains en ressortiront assez inspirés pour se mettre à l'action à différents niveaux. J'avoue qu'entendre une fillette d'une dizaine d'années dire à sa mère, devant un dispositif de l'exposition : "c'est intéressant comme métier, paléontologue", m'a particulièrement réjoui.
jeudi 23 juillet 2015
La valeur de l'effort
Vous êtes-vous déjà laissés embarquer, par des amis bien intentionnés, dans une marche en montagne, ou dans une ballade à vélo dans une région un peu accidentée, alors que vous étiez peu entraînés? Alors vous connaissez sans doute les sentiments que procure la lecture de Amour et maths d'Edward Frenkel, publié il y a quelques mois par les éditions Flammarion. On vous a promis que le paysage serait splendide, vous éprouvez de nombreuses difficultés sur le parcours, au point d'être parfois tentés d'abandonner, mais vous êtes finalement bien contents d'être allé au bout. Et si vous ne savez plus raconter précisément ce que vous avez vu, vous affirmez sans hésiter que cette expérience en valait la peine. Au point que vous en parlez encore des années après.
Edward Frenkel est mathématicien. Il enseigne aujourd'hui à l'université de Berkeley, aux Etats-Unis. Mais il a été élevé à Kolomna, à une centaine de kilomètres de Moscou, en URSS. En URSS, puisque c'est ainsi que se nommait le pays qu'il a quitté en 1989, à seulement 21 ans.
En suivant son autobiographie scientifique, on passe des groupes de symétries à la théorie des groupes, puis au "programme de Langlands", qui vise à relier la "théorie des nombres", les "courbes sur les corps finis", les "surfaces de Riemann" et, même, la physique quantique. Je m'abstiendrai ici d'expliquer de quoi il s'agit. Edward Frenkel le fait largement dans les 365 pages de son ouvrage. Il propose aussi de nombreuses notes et références pour les lecteurs opiniâtres et vraiment désireux de comprendre ces mathématiques difficiles.
Car là n'est pas l'essentiel de ce livre. Ce que vise avant tout Edward Frenkel, c'est de nous communiquer "ce que c'est que de faire des mathématiques". Sa méthode : intriquer les résultats scientifiques qu'il expose avec les épisodes de sa vie auxquels ils sont associés. Pas de déballage personnel toutefois : il se limite strictement à ce qui concerne ses études et son travail universitaire (au point que, s'il n'évoquait sa famille et, furtivement, une petite amie, on se demanderait presque s'il a des relations et des sentiments en dehors des mathématiques).
D'Evgeny Evgenievich Petrov, professeur de mathématiques à Kolomna, qui lui fit comprendre que les mathématiques pouvaient être aussi passionnantes que la physique des particules, à Edward Witten, avec lequel il travailla justement à rapprocher la physique fondamentale du programme de Langlands, on le suit ainsi dans une succession de rencontres. Peut être, finalement, est-ce la façon d'Edward Frenkel d'entrer en relation : parler et faire des mathématiques avec d'autres personnes? L'épilogue du livre, où il narre en détails pourquoi et comment il a produit un court-métrage intitulé "Rites d'amour et de maths" semble le confirmer. Non autobiographique, certifie-t-il, cette histoire d'un mathématicien qui tatoue sur la peau de sa maîtresse une "formule de l'amour" (une "belle" formule, en fait), a pour but de faire ressentir aux spectateurs les liens qu'il éprouve entre les mathématiques et la vie de façon générale.
Pour ce qui me concerne, j'en reste admiratif. Comme je peux admirer les exploits d'alpinistes, de navigateurs solitaires ou de plongeurs apnéistes. Et cela m'incite à aller au bout de mes propres passions, même s'il s'agit seulement de marche en montagne ou de promenade à vélo. Ce n'est déjà pas si mal.
En suivant son autobiographie scientifique, on passe des groupes de symétries à la théorie des groupes, puis au "programme de Langlands", qui vise à relier la "théorie des nombres", les "courbes sur les corps finis", les "surfaces de Riemann" et, même, la physique quantique. Je m'abstiendrai ici d'expliquer de quoi il s'agit. Edward Frenkel le fait largement dans les 365 pages de son ouvrage. Il propose aussi de nombreuses notes et références pour les lecteurs opiniâtres et vraiment désireux de comprendre ces mathématiques difficiles.
Car là n'est pas l'essentiel de ce livre. Ce que vise avant tout Edward Frenkel, c'est de nous communiquer "ce que c'est que de faire des mathématiques". Sa méthode : intriquer les résultats scientifiques qu'il expose avec les épisodes de sa vie auxquels ils sont associés. Pas de déballage personnel toutefois : il se limite strictement à ce qui concerne ses études et son travail universitaire (au point que, s'il n'évoquait sa famille et, furtivement, une petite amie, on se demanderait presque s'il a des relations et des sentiments en dehors des mathématiques).
D'Evgeny Evgenievich Petrov, professeur de mathématiques à Kolomna, qui lui fit comprendre que les mathématiques pouvaient être aussi passionnantes que la physique des particules, à Edward Witten, avec lequel il travailla justement à rapprocher la physique fondamentale du programme de Langlands, on le suit ainsi dans une succession de rencontres. Peut être, finalement, est-ce la façon d'Edward Frenkel d'entrer en relation : parler et faire des mathématiques avec d'autres personnes? L'épilogue du livre, où il narre en détails pourquoi et comment il a produit un court-métrage intitulé "Rites d'amour et de maths" semble le confirmer. Non autobiographique, certifie-t-il, cette histoire d'un mathématicien qui tatoue sur la peau de sa maîtresse une "formule de l'amour" (une "belle" formule, en fait), a pour but de faire ressentir aux spectateurs les liens qu'il éprouve entre les mathématiques et la vie de façon générale.
Pour ce qui me concerne, j'en reste admiratif. Comme je peux admirer les exploits d'alpinistes, de navigateurs solitaires ou de plongeurs apnéistes. Et cela m'incite à aller au bout de mes propres passions, même s'il s'agit seulement de marche en montagne ou de promenade à vélo. Ce n'est déjà pas si mal.
jeudi 9 juillet 2015
Türing : un test pour les cinéastes
Je suis allé voir Ex machina, premier film en tant que réalisateur d'Alex Garland, qui a par ailleurs derrière lui de solides états de service comme scénariste. Je ne me suis pas ennuyé, mais je suis déçu par le traitement du sujet. Plus que le film sur les interactions entre les hommes et les intelligences artificielles qu'il prétend être, c'est un film somme toute assez classique de manipulation, où l'on ne sait d'ailleurs plus, à la fin, qui manipule qui.
Attention, à partir d'ici, je risque de dévoiler quelques ressorts importants de l'intrigue.
Je fais le pitch quand même : Caleb, jeune programmeur pour un très gros moteur de recherches sur Internet, est invité à passer une semaine dans la maison très isolée de Nathan, son patron richissime. Là, il apprend qu'il doit tester la conscience d'Ava, androïde dotée d'intelligence artificielle, invention de Nathan (décidément aussi doué en mécanique qu'en informatique), et qui a les traits d'une jolie jeune femme.
Peut-être ce film donnera-t-il à certains
l'envie d'en savoir plus sur le test de Türing (le jeu de l'imitation), sur l'histoire de Marie
(qui sait tout sur les couleurs mais vit dans un monde en noir en blanc,
et ne peut donc éprouver dans sa conscience la "rougitude" du rouge),
et plus généralement sur les recherches en intelligence artificielle.
Pour ce qui concerne Türing, on comprend bien les limites du test :
celui-ci a été proposé en termes si généraux que personne ne sait
vraiment comment le construire réellement. Comme la "machine de Türing",
censée être le prototype de l'ordinateur, mais qui est restée à un état
purement théorique.
La
problématique du personnage de Caleb, qui doit imaginer des questions
pour évaluer le degré de conscience d'Ava, est assez bien
posée pour qu'on s'y intéresse. Et le film ne donne aucune réponse :
l'IA "sort du cadre" à la fin, comme l'avait justement suggéré Caleb,
mais on n'en sait pas plus sur ses pensées, si pensées il y a. Tout au
plus peut-on comprendre qu'elle n'est pas très douée d'empathie,
abandonnant le pauvre Caleb à un sort peu enviable.
Le réalisateur brouille toutefois l'intrigue, en la transformant en banale intrigue de manipulation : l'IA prisonnière tente de s'allier avec Caleb pour se libérer de l'emprise de Nathan. Mais ce dernier, qui a tout prévu, déjoue le plan. Mais Caleb, moins naïf qu'il n'en a l'air, a joué un coup d'avance...
On s'y perd un peu, jusque dans les objectifs du prétendu test : pourquoi Nathan a-t-il donné à Ava une apparence adaptée aux goûts féminins de Caleb? S'agit-il seulement d'un test "consommateur" destiné à vérifier qu'il peut commercialiser ses IA comme compagnes domestiques (et soumises, y compris sexuellement, telle la domestique Kyoko)? Le fait que toutes ces IA soient fondées sur Bluebook, un Google qui aurait pris l'hégémonie sur les recherches Internet (ce que Google, malgré les fantasmes, est loin d'avoir fait) brouille encore plus les pistes.
Au final, ce film n'apporte pas grand chose à la fiction sur les IA. En sortant de la salle, je me suis même amusé à faire le jeu des sept ressemblances avec Blade Runner (1982, quand même). Et j'en ai trouvé neuf (il y en a peut-être d'autres, il faudrait que je revoie le film de Ridley Scott) :
- le personnage central fait passer des tests à des IA, pour déterminer leur vraie nature ;
- à un moment, on doute, avec lui, de sa propre humanité (la possibilité que Deckard soit lui même un replicant est plus subtilement suggérée dans Blade Runner) ;
- il tombe amoureux d'une IA, bien qu'il sache que c'en est une ;
- celle-ci ressemble d'ailleurs à son idéal féminin (à son ex-maîtresse dans Blade Runner) ;
- il tente de la sauver de son créateur qui en a programmé la destruction ;
- créateur qui vit seul et reclus (en haut d'un immeuble dans Blade Runner, au fin fond d'une forêt montagneuse ici : les montagnes remplacent les buildings) ;
- créateur qu'elle déteste ;
- et qu'elle finira par tuer ;
- et même, on mange de la nourriture asiatique, avec des baguettes!
Que je préfère Harrison Ford à Domhnall Gleeson n'est sans doute qu'une question de génération (et on souhaite une meilleure carrière à Alicia Vikander qu'à Sean Young).
samedi 4 juillet 2015
Hommage aux frères Bogdanov
Etrangement, les amateurs de science cliquent volontiers sur tous les liens renvoyant vers des articles traitant des frères Bogdanov. Pour vous permettre de satisfaire ce penchant malsain, j'ai rassemblé ici les liens vers les pages de La Recherche contenant les critiques que j'ai consacrées à leurs livres. La rubrique s'appelait "Touche pas à ma science".
Au commencement du temps (2009)
Le visage de Dieu (2010)
Le visage de Dieu - édition augmentée (2011)
Le dernier jour des dinosaures (2011)
La pensée de Dieu (2012)
Le mystère du satellite Planck (2013)
Bien entendu, je ne suis pas le seul à avoir émis des critiques très négatives sur les ouvrages imprimés de ces deux individus. Mais je prétends faire partie du club très fermé de ceux qui ont lu intégralement tous ces ouvrages (je n'arrive pas à croire, d'ailleurs, qu'eux mêmes en fassent partie). Les autres membres peuvent se signaler dans les commentaires, et poster des liens vers leurs propres critiques s'ils en ont publié.
Il y a un dernier point pour lequel il faut remercier les Bogdanov. Ils donnent un argument massue au critique de livres de science qui se verrait opposer des arguments du type : "comment pouvez-vous émettre des remarques négatives sur ce livre qui s'est si bien vendu?" ou encore "mais les lecteurs ont bien aimé ce que justement vous reprochez à l'ouvrage". Les livres mentionnés ci-dessus, et tous les autres signés des mêmes auteurs que je n'ai pas lus (je ne suis pas masochiste non plus) se sont tous très bien vendus. Et beaucoup de lecteurs ont aimé ça. Comme quoi!
Au commencement du temps (2009)
Le visage de Dieu (2010)
Le visage de Dieu - édition augmentée (2011)
Le dernier jour des dinosaures (2011)
La pensée de Dieu (2012)
Le mystère du satellite Planck (2013)
Bien entendu, je ne suis pas le seul à avoir émis des critiques très négatives sur les ouvrages imprimés de ces deux individus. Mais je prétends faire partie du club très fermé de ceux qui ont lu intégralement tous ces ouvrages (je n'arrive pas à croire, d'ailleurs, qu'eux mêmes en fassent partie). Les autres membres peuvent se signaler dans les commentaires, et poster des liens vers leurs propres critiques s'ils en ont publié.
Il y a un dernier point pour lequel il faut remercier les Bogdanov. Ils donnent un argument massue au critique de livres de science qui se verrait opposer des arguments du type : "comment pouvez-vous émettre des remarques négatives sur ce livre qui s'est si bien vendu?" ou encore "mais les lecteurs ont bien aimé ce que justement vous reprochez à l'ouvrage". Les livres mentionnés ci-dessus, et tous les autres signés des mêmes auteurs que je n'ai pas lus (je ne suis pas masochiste non plus) se sont tous très bien vendus. Et beaucoup de lecteurs ont aimé ça. Comme quoi!
vendredi 3 juillet 2015
Vulgarisation et BD
J'avais entendu parler de "L'Art préhistorique en bande dessinée" (notamment par l'auteur, Eric Le Brun, dont je suis "ami" sur FB). Deux tomes ont été publiés en 2012 et en 2013 par Glénat. Mais je n'avais pas lu. Le coût très modique de ces deux petits albums (5€ et 7,5€) m'a incité à les acheter dans la boutique de Lascaux 2. J'ai été surpris, je ne m'attendais pas à ce que j'ai vu/lu (les deux dimensions sont importantes dans la BD).
D'abord, il faut saluer le travail documentaire de l'auteur. Une bonne partie de ses dessins reproduisent de façon très évocatrice des oeuvres du Paléolithique supérieur. Art rupestre ou mobilier, il navigue habilement entre la fidélité aux originaux et l'unité de son propre style. Le choix du dessin au trait noir, seulement rehaussé par endroit par du rouge, dans le premier volume est à cet égard très heureux. Il y a un peu plus de couleur dans le second volume, mais elle reste assez discrète.
Le premier volume est consacré exclusivement à l'Aurignacien. Le second nous laisse à l'orée du Magdalénien (ce qui laisse penser que l'auteur a au moins une troisième époque en préparation). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que rien n'est oublié. L'auteur ne se contente pas de nous présenter les principaux sites : il consacre aussi des cases, ne serait-ce qu'une, à des grottes moins connues. Il aborde aussi, brièvement, quelques pratiques culturelles qui ont laissé des traces archéologiques, telles que les sépultures ou les tentatives de tissage, ainsi que la musique.
Habilement aussi, l'auteur se contente de montrer les vestiges archéologiques. Il ne prend pas parti dans les querelles entre spécialistes quant aux motivations sous-jacentes à cet "art" préhistorique (cela dit, en le qualifiant d'art, il prend parti, c'est inévitable). Il ne fait pas non plus de concessions à la fiction, comme le terme de "bande dessinée" pouvait le laisser penser, esquissant à peine quelques mises en scène. Cela lui évite, là aussi, les controverses inutiles sur le réalisme de ses restitutions
J'ai été un peu dérouté par l'aspect "catalogue" de la fin du second volume. A force de tout montrer, l'auteur nous perd un peu dans la multiplication des sites. Mais c'est assumé : la partie entièrement documentaire qui clôt chacun des ouvrages, avec cartes, listes de sites et lexique en souligne l'aspect pédagogique. Nul doute que les plus jeunes y trouverons du grain à moudre. Je n'hésiterais en tous cas pas à offrir ces livres à des enfants dès la manifestation chez eux d'un signe d'intérêt pour la préhistoire : on ne sait jamais ce qui peut entretenir une passion, et il y a là tout à fait matière.
Pour conclure, un petit regret quand même : ces deux livres ne sont consacrés qu'à l'art préhistorique en Europe à partir de l'arrivée de l'homme moderne. Ils ignorent donc ce qui s'est passé dans les autres parties du monde, et dans les périodes plus anciennes. C'est particulièrement frappant dès le début du premier volume, quand l'auteur aborde, avec raison, la question des parures : dents et coquillages percés. N'oublions pas que de tels objets ont été fabriqués il y a au moins 75 000 ans en Afrique, à une date aussi éloigné des Aurignaciens que ceux-ci le sont de nous-mêmes. Il y aurait donc certainement un autre volume (intitulé "Epoque zéro"?) à dessiner.
D'abord, il faut saluer le travail documentaire de l'auteur. Une bonne partie de ses dessins reproduisent de façon très évocatrice des oeuvres du Paléolithique supérieur. Art rupestre ou mobilier, il navigue habilement entre la fidélité aux originaux et l'unité de son propre style. Le choix du dessin au trait noir, seulement rehaussé par endroit par du rouge, dans le premier volume est à cet égard très heureux. Il y a un peu plus de couleur dans le second volume, mais elle reste assez discrète.
Le premier volume est consacré exclusivement à l'Aurignacien. Le second nous laisse à l'orée du Magdalénien (ce qui laisse penser que l'auteur a au moins une troisième époque en préparation). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que rien n'est oublié. L'auteur ne se contente pas de nous présenter les principaux sites : il consacre aussi des cases, ne serait-ce qu'une, à des grottes moins connues. Il aborde aussi, brièvement, quelques pratiques culturelles qui ont laissé des traces archéologiques, telles que les sépultures ou les tentatives de tissage, ainsi que la musique.
Habilement aussi, l'auteur se contente de montrer les vestiges archéologiques. Il ne prend pas parti dans les querelles entre spécialistes quant aux motivations sous-jacentes à cet "art" préhistorique (cela dit, en le qualifiant d'art, il prend parti, c'est inévitable). Il ne fait pas non plus de concessions à la fiction, comme le terme de "bande dessinée" pouvait le laisser penser, esquissant à peine quelques mises en scène. Cela lui évite, là aussi, les controverses inutiles sur le réalisme de ses restitutions
J'ai été un peu dérouté par l'aspect "catalogue" de la fin du second volume. A force de tout montrer, l'auteur nous perd un peu dans la multiplication des sites. Mais c'est assumé : la partie entièrement documentaire qui clôt chacun des ouvrages, avec cartes, listes de sites et lexique en souligne l'aspect pédagogique. Nul doute que les plus jeunes y trouverons du grain à moudre. Je n'hésiterais en tous cas pas à offrir ces livres à des enfants dès la manifestation chez eux d'un signe d'intérêt pour la préhistoire : on ne sait jamais ce qui peut entretenir une passion, et il y a là tout à fait matière.
Pour conclure, un petit regret quand même : ces deux livres ne sont consacrés qu'à l'art préhistorique en Europe à partir de l'arrivée de l'homme moderne. Ils ignorent donc ce qui s'est passé dans les autres parties du monde, et dans les périodes plus anciennes. C'est particulièrement frappant dès le début du premier volume, quand l'auteur aborde, avec raison, la question des parures : dents et coquillages percés. N'oublions pas que de tels objets ont été fabriqués il y a au moins 75 000 ans en Afrique, à une date aussi éloigné des Aurignaciens que ceux-ci le sont de nous-mêmes. Il y aurait donc certainement un autre volume (intitulé "Epoque zéro"?) à dessiner.
mercredi 1 juillet 2015
Du blog au livre
Puisque vous lisez ceci, c'est que vous appréciez le genre "blog". Dans quelle mesure les articles (pardon, les posts) publiés au fil de l'eau peuvent-ils être rassemblés pour former un livre? Ou, plutôt, une collection de posts peut-elle former un livre avec un propos?
C'est la question que je me suis posée en lisant "Le coup de la girafe", de Léo Grasset, que Le Seuil a publié au printemps dernier dans la collection Science Ouverte. L'origine "blog" de l'ouvrage est en effet clairement revendiquée dès le Préambule. Et l'auteur de préciser que l'audience à laquelle ces textes étaient destinés lui semblait plutôt réduite.
Premier point : ce livre se lit facilement. Léo Grasset a un certain talent pour raconter des histoires. On ne s'ennuie pas. Le très grand public devrait y trouver en grande partie son compte.
Mais je ne suis pas certain que cette collection hétéroclite d'histoires et d'essais, dont le seul point commun est qu'ils traitent d'histoire naturelle, constitue un livre. Il y a certes une tentative de classement des articles, devenus des chapitres, en quatre parties (L'évolution dans tous ses états, Comportements animaux, Drôles de bêtes, Les hommes et les savanes), mais on n'y distingue ni progression, ni démonstration d'ensemble. Le mystère reste entier quant à ce que veut nous dire l'auteur (à part peut-être "lanature est merveilleuse"?)
C'est d'ailleurs l'un des défauts récurrents de nombreux blogs tenus par des scientifiques et amateurs de vulgarisation : leurs auteurs pensent qu'il suffit de raconter des histoires qui les intéressent pour que celles-ci retiennent l'attention des lecteurs. Certes, ils s'appuient parfois sur l'actualité (à propos de la communication chez les éléphants ici, par exemple), mais ils peuvent tout aussi bien reprendre des connaissances établies plus anciennement, voire déjà exposées ailleurs (l'auto-organisation des bancs de poissons, par exemple).
J'ai apprécié, il faut le reconnaître, l'enthousiasme de Léo Grasset pour le ratel. Mais pourquoi nous en parle-t-il? On se demande quelle est sa place, coincé entre les bousiers, les éléphants et les lions.
Le sous titre du livre "Des savants dans la savane" (ah! ah!) donnait pourtant une piste. D'autant que l'auteur nous dit avoir écrit ces textes pendant un séjour de terrain au Zimbabwe. On se serait attendu à ce qu'il ancre ses réflexions sur son propre travail. Mais ce qu'il a fait, justement, sur le terrain, il n'en dit rien, à part quelques allusions peu explicites. Quand aux chercheurs dont il mentionne les travaux, il ne nous permet pas non plus de les rencontrer. C'est dommage.
Je me suis aussi demandé pourquoi l'éditeur avait placé un cahier photo au centre de ce livre. Entassées par manque de place, souvent sans autre but que de nous montrer à peu près les animaux dont l'auteur parle ailleurs dans le livre, et avec des légendes à rallonge difficile à lire, elles n'enrichissent pas réellement le texte principal (illustré par ailleurs de quelques schémas).
Quant aux nombreuses références en fin d'ouvrage, elles témoignent au mieux d'une absence de réflexion sur le public visé, au pire de cuistrerie. Les publications indiquées sont inaccessibles (physiquement ou intellectuellement) à la plupart des lecteurs qui apprécieront réellement le livre. Quant aux naturalistes qui liraient ce qu'a écrit leur jeune collègue, elles leur seront tout à fait superflues.
Les amateurs d'histoires naturelles prendront plaisir à cette lecture. Cet auteur a indubitablement du potentiel s'il persiste dans la vulgarisation. On ne peut que souhaiter qu'il rencontrera des éditeurs qui le guideront pour le développer.
C'est la question que je me suis posée en lisant "Le coup de la girafe", de Léo Grasset, que Le Seuil a publié au printemps dernier dans la collection Science Ouverte. L'origine "blog" de l'ouvrage est en effet clairement revendiquée dès le Préambule. Et l'auteur de préciser que l'audience à laquelle ces textes étaient destinés lui semblait plutôt réduite.
Premier point : ce livre se lit facilement. Léo Grasset a un certain talent pour raconter des histoires. On ne s'ennuie pas. Le très grand public devrait y trouver en grande partie son compte.
Mais je ne suis pas certain que cette collection hétéroclite d'histoires et d'essais, dont le seul point commun est qu'ils traitent d'histoire naturelle, constitue un livre. Il y a certes une tentative de classement des articles, devenus des chapitres, en quatre parties (L'évolution dans tous ses états, Comportements animaux, Drôles de bêtes, Les hommes et les savanes), mais on n'y distingue ni progression, ni démonstration d'ensemble. Le mystère reste entier quant à ce que veut nous dire l'auteur (à part peut-être "lanature est merveilleuse"?)
C'est d'ailleurs l'un des défauts récurrents de nombreux blogs tenus par des scientifiques et amateurs de vulgarisation : leurs auteurs pensent qu'il suffit de raconter des histoires qui les intéressent pour que celles-ci retiennent l'attention des lecteurs. Certes, ils s'appuient parfois sur l'actualité (à propos de la communication chez les éléphants ici, par exemple), mais ils peuvent tout aussi bien reprendre des connaissances établies plus anciennement, voire déjà exposées ailleurs (l'auto-organisation des bancs de poissons, par exemple).
J'ai apprécié, il faut le reconnaître, l'enthousiasme de Léo Grasset pour le ratel. Mais pourquoi nous en parle-t-il? On se demande quelle est sa place, coincé entre les bousiers, les éléphants et les lions.
Le sous titre du livre "Des savants dans la savane" (ah! ah!) donnait pourtant une piste. D'autant que l'auteur nous dit avoir écrit ces textes pendant un séjour de terrain au Zimbabwe. On se serait attendu à ce qu'il ancre ses réflexions sur son propre travail. Mais ce qu'il a fait, justement, sur le terrain, il n'en dit rien, à part quelques allusions peu explicites. Quand aux chercheurs dont il mentionne les travaux, il ne nous permet pas non plus de les rencontrer. C'est dommage.
Je me suis aussi demandé pourquoi l'éditeur avait placé un cahier photo au centre de ce livre. Entassées par manque de place, souvent sans autre but que de nous montrer à peu près les animaux dont l'auteur parle ailleurs dans le livre, et avec des légendes à rallonge difficile à lire, elles n'enrichissent pas réellement le texte principal (illustré par ailleurs de quelques schémas).
Quant aux nombreuses références en fin d'ouvrage, elles témoignent au mieux d'une absence de réflexion sur le public visé, au pire de cuistrerie. Les publications indiquées sont inaccessibles (physiquement ou intellectuellement) à la plupart des lecteurs qui apprécieront réellement le livre. Quant aux naturalistes qui liraient ce qu'a écrit leur jeune collègue, elles leur seront tout à fait superflues.
Les amateurs d'histoires naturelles prendront plaisir à cette lecture. Cet auteur a indubitablement du potentiel s'il persiste dans la vulgarisation. On ne peut que souhaiter qu'il rencontrera des éditeurs qui le guideront pour le développer.
jeudi 18 juin 2015
Evariste
Un jeune auteur littéraire qui raconte
Evariste Galois, c'est sans aucun doute intéressant, me suis-je
dit en achetant il y a quelques jours Evariste, de François-Henri Désérable
(Gallimard, 2015, 172 p., 16,90€). J'avais, hélas, tort. J'ai appris qu'il avait reçu le prix des lecteurs L'Express/BFMTV en 2015 : cela me confirme dans le fait de ne pas lire cet hebdomadaire et de ne pas regarder cette chaîne de télévision.
J'ai acheté ce livre pour découvrir comment un jeune auteur actuel allait réinventer un récit autour de l'histoire archi connue de Galois. Mais il ne réinvente rien. Il se contente de raconter le jeune héros romantique, génie foudroyé à 20 ans, de la façon la plus classique qui soit.
Son seul procédé littéraire est de s'adresser à une "jeune fille", dans le souci semble-t-il de la séduire. Effectivement, quoi de plus moderne que de tenter de séduire une jeune fille en lui narrant l'histoire d'un héros romantique? J'en fréquente quelques unes assez assidument, et bien qu'elles ne me racontent évidement pas tout, je n'ai pas le sentiment qu'elles donneraient dans un tel panneau.
Ah, si! Comme il est moderne, l'auteur parle crûment de sexe : de la conception d'Evariste à ses fantasmes vis-à-vis de celle qui, pense-t-on, motiva le duel qui lui coûta la vie, en passant par ses plaisirs solitaires dans le dortoir du lycée Louis-le-Grand. Et comme il est moderne (et qu'il a lu Céline, sans doute) il décrit aussi crûment la misère et le peuple, sans aucune compassion. Pour procurer à la "jeune fille", elle aussi moderne, un frisson de dégoût, qu'elle pourrait confondre avec un frisson de plaisir? Quitte à se moquer des pauvres, je préfère encore Les rois de la Suède.
En outre, ce bref récit n'apporte rien
à la connaissance de Galois. Ses mathématiques n'intéressent pas l'auteur. Il revendique même n'y rien comprendre.
Je doute donc, hélas, que des lecteurs de
ce « roman » (en est-ce vraiment un?) en tirent un
intérêt quelconque pour les mathématiques. C'est pourtant là
qu'est le nœud de l'affaire : Galois eut-il été commerçant ou
cordonnier, on n'en parlerait plus aujourd'hui. Tenter de comprendre
en quoi tenait son « génie » (et aussi la filiation de
ses travaux avec d'autres, qui l'avaient précédé), c'est la moindre
des choses si l'on veut lui rendre hommage, aussi maladroitement
qu'on le fasse. Pour faire un jeu de mot comme semble les affectionner François-Henri
Désérable, ce livre n'est en rien désirable. D'exécrable, plutôt.
Je suggère, pour à peu près le même prix, de trouver d'occasion "Le roman d'Evariste Galois", de Leopold Infeld (La Farandole, 1978). Il n'en donne pas tellement plus sur les mathématiques, mais est sans aucun doutes plus agréable à lire (d'accord, c'est un souvenir d'adolescent). Si l'on veut entrer un peu dans le dur de la science, il y a Galois, de Norbert Verdier (Pour la Science, 2011). Enfin, Images des mathématiques a regroupé sur la même page une série d'articles "Autour de Galois", historiques pour certains, plus mathématiques pour d'autres.
lundi 15 juin 2015
Visiter la grotte de Rouffignac
Comme vous pouvez le lire ici, j'ai visité récemment la grotte de Rouffignac, en Dordogne. Plus justement nommée Cro de Granville, elle est aussi connue sous l'appellation de "grotte aux 100 mammouths", tant cet animal, rare par ailleurs dans l'art préhistorique, y est présent. En sortant, j'ai acheté un petit livre intitulé "Visiter la grotte de Rouffignac", signé de Marie-Odile et Jean Plassard, et publié en 1995 aux éditions Sud-Ouest (l'édition que j'ai achetée a été mise à jour en 2001).
Comme son nom l'indique, c'est un guide de visite. Il reprend peu ou prou le commentaire du guide, en l'étoffant de quelques détails, mais à peine. C'est un bon aide mémoire postérieur à la visite. Si on le trouve avant, sa lecture, qui ne prend pas plus d'une heure, est aussi une bonne préparation de celle-ci. Dans les grottes ornées, le temps est toujours trop court, et il n'est jamais inutile d'être préparé à ce que l'on va voir, afin d'en profiter pleinement.
Ce livre colle tellement à la visite qu'il ne nous montre presque aucune image des figures que l'on ne voit pas pendant celle-ci. Seuls le "mammouth à l'oeil coquin" et le "pharaon" (un bison) ont cet honneur. Heureusement, j'ai conservé le beau livre sur Rouffignac publié en 1999 par les éditions du Seuil et signé également par Jean Plassard. Il ne figure plus aujourd'hui au catalogue de l'éditeur. Ce sera l'un de mes prochaines lectures.
Comme son nom l'indique, c'est un guide de visite. Il reprend peu ou prou le commentaire du guide, en l'étoffant de quelques détails, mais à peine. C'est un bon aide mémoire postérieur à la visite. Si on le trouve avant, sa lecture, qui ne prend pas plus d'une heure, est aussi une bonne préparation de celle-ci. Dans les grottes ornées, le temps est toujours trop court, et il n'est jamais inutile d'être préparé à ce que l'on va voir, afin d'en profiter pleinement.
Ce livre colle tellement à la visite qu'il ne nous montre presque aucune image des figures que l'on ne voit pas pendant celle-ci. Seuls le "mammouth à l'oeil coquin" et le "pharaon" (un bison) ont cet honneur. Heureusement, j'ai conservé le beau livre sur Rouffignac publié en 1999 par les éditions du Seuil et signé également par Jean Plassard. Il ne figure plus aujourd'hui au catalogue de l'éditeur. Ce sera l'un de mes prochaines lectures.
dimanche 14 juin 2015
Altamira
A l'exception du guide de visite du musée que j'ai acheté sur place, il ne semble pas qu'il y ait aujourd'hui de livre en français disponible consacré à la grotte d'Altamira. S'agissant de la première grotte ornée du Paléolithique annoncée comme telle, dès 1879, c'est étonnant. Il faut croire que l'intérêt du public pour ces sites, en dehors des activités touristiques, n'est peut-être pas aussi important qu'on veut bien le dire (si j'en crois une rapide recherche sur Amazon.es, il n'y en a pas beaucoup non plus en espagnol!).
J'avais heureusement conservé dans ma bibliothèque le livre de Leslie Freeman et Joaquin Gonzalez Echegaray publié en 2001 par l'éphémère Maison des Roches, et intitulé sobrement "La grotte d'Altamira". On le trouve encore, neuf ou d'occasion, chez des libraires en lignes, et sans doute chez des libraires spécialisés. Avec ses 154 pages et ses nombreuses reproductions en couleur, et malgré son format restreint (19,5 par 22,5 cm), il donne une bonne approche de ce chef d'oeuvre de l'humanité
Quelques chapitres introductifs permettent une mise en contexte, avec la présentation du cadre naturel et culturel dans lequel les peintures ont été produites il y a au moins 14 000 ans, et avec le récit de la découverte et de la controverse qui s'en est suivi (en attendant que celle-ci soit racontée dans un film). Mais le coeur de l'ouvrage tient dans la description des oeuvres dans toute la grotte (et pas seulement celles du célébre plafond qualifié à l'époque de "Chapelle sixtine de la préhistoire") et dans une proposition d'interprétation.
Il est toujours difficile pour le profane que je suis de se faire une opinion sur le discours scientifique en matière d'art rupestre. Les animaux sont-ils bien identifiés? Leurs positions bien reconnues? Les comparaisons éthologiques bien établies? Ces réserves posées, la présentation des deux auteurs m'a semblé convaincante.
Selon eux, le grand plafond est essentiellement la représentation d'un troupeau de bisons en période de rut. La présence à proximité d'autres animaux (biche, cheval) n'a rien d'étonnant : ces espèces cohabitent naturellement, et pouvaient donc être observées à proximité les unes des autres. Evidemment, il est bien difficile de comprendre pourquoi des hommes sont venus peindre un plafond dans une salle où ils ne pouvaient pas se tenir debout, et encore moins contempler l'ensemble de la composition d'un seul regard, comme les aménagements pratiqués au début du XXe siècle permettent maintenant de le faire (on retrouve la même situation par exemple dans un secteur de la grotte de Rouffignac, en Dordogne).
Les auteurs penchent pour des rites d'initiation. Ils argumentent ce point surtout pour les peintures et les dessins réalisés dans des galeries très étroites, plus loin dans la grotte. Certaines figures sont visibles en entrant, d'autres en sortant, le tout en rampant. Et, poliment mais fermement, ils réfutent les hypothèses "chamaniques", très publicisées à l'époque de la publication du livre, et encore très présentes aujourd'hui dans les commentaires des guides qui font visiter les grottes ornées préhistoriques.
La dernière partie consacrée aux vestiges archéologiques aurait pu être plus courte. Pourquoi décrire par le menu les outils et la faune trouvés sur place, si c'est pour conclure que les fouilles ont été mal conduites au début du XXe siècle, qu'il n'a pas été possible de conduire convenablement de nouvelles fouilles depuis, et qu'on ne sait donc pas grand chose sur les relations entre le site d'habitat présent sous le porche d'entrée et les peintures situées plus profondément dans la grotte? Ah, si, quand même, on apprend que les animaux représentés n'étaient pas très différents des animaux chassés, au contraire d'une conclusion d'André Leroi-Gourhan après son étude d'un certain nombre de grottes françaises. Un point, là encore, trop souvent répété sans vérification par de nombreux guides.
J'avais heureusement conservé dans ma bibliothèque le livre de Leslie Freeman et Joaquin Gonzalez Echegaray publié en 2001 par l'éphémère Maison des Roches, et intitulé sobrement "La grotte d'Altamira". On le trouve encore, neuf ou d'occasion, chez des libraires en lignes, et sans doute chez des libraires spécialisés. Avec ses 154 pages et ses nombreuses reproductions en couleur, et malgré son format restreint (19,5 par 22,5 cm), il donne une bonne approche de ce chef d'oeuvre de l'humanité
Quelques chapitres introductifs permettent une mise en contexte, avec la présentation du cadre naturel et culturel dans lequel les peintures ont été produites il y a au moins 14 000 ans, et avec le récit de la découverte et de la controverse qui s'en est suivi (en attendant que celle-ci soit racontée dans un film). Mais le coeur de l'ouvrage tient dans la description des oeuvres dans toute la grotte (et pas seulement celles du célébre plafond qualifié à l'époque de "Chapelle sixtine de la préhistoire") et dans une proposition d'interprétation.
Il est toujours difficile pour le profane que je suis de se faire une opinion sur le discours scientifique en matière d'art rupestre. Les animaux sont-ils bien identifiés? Leurs positions bien reconnues? Les comparaisons éthologiques bien établies? Ces réserves posées, la présentation des deux auteurs m'a semblé convaincante.
Selon eux, le grand plafond est essentiellement la représentation d'un troupeau de bisons en période de rut. La présence à proximité d'autres animaux (biche, cheval) n'a rien d'étonnant : ces espèces cohabitent naturellement, et pouvaient donc être observées à proximité les unes des autres. Evidemment, il est bien difficile de comprendre pourquoi des hommes sont venus peindre un plafond dans une salle où ils ne pouvaient pas se tenir debout, et encore moins contempler l'ensemble de la composition d'un seul regard, comme les aménagements pratiqués au début du XXe siècle permettent maintenant de le faire (on retrouve la même situation par exemple dans un secteur de la grotte de Rouffignac, en Dordogne).
Les auteurs penchent pour des rites d'initiation. Ils argumentent ce point surtout pour les peintures et les dessins réalisés dans des galeries très étroites, plus loin dans la grotte. Certaines figures sont visibles en entrant, d'autres en sortant, le tout en rampant. Et, poliment mais fermement, ils réfutent les hypothèses "chamaniques", très publicisées à l'époque de la publication du livre, et encore très présentes aujourd'hui dans les commentaires des guides qui font visiter les grottes ornées préhistoriques.
La dernière partie consacrée aux vestiges archéologiques aurait pu être plus courte. Pourquoi décrire par le menu les outils et la faune trouvés sur place, si c'est pour conclure que les fouilles ont été mal conduites au début du XXe siècle, qu'il n'a pas été possible de conduire convenablement de nouvelles fouilles depuis, et qu'on ne sait donc pas grand chose sur les relations entre le site d'habitat présent sous le porche d'entrée et les peintures situées plus profondément dans la grotte? Ah, si, quand même, on apprend que les animaux représentés n'étaient pas très différents des animaux chassés, au contraire d'une conclusion d'André Leroi-Gourhan après son étude d'un certain nombre de grottes françaises. Un point, là encore, trop souvent répété sans vérification par de nombreux guides.
jeudi 11 juin 2015
La grotte de Font-de-Gaume
Mes lectures sont très orientées vers
l'art rupestre décidément, ces temps-ci. Puisque j'allais visiter
la grotte de Font-de-Gaume, aux Eyzies-de-Tayac, j'ai ressorti le
livre de Jean-Jacques Cleyet-Merle publié il y a un an aux Editions
du Patrimoine. Il est évidemment en vente dans toutes les bonnes
librairies de préhistoire, à commencer par celles des Eyzies, au
prix très modique de 12€.
On y trouve exactement ce que l'on peut
attendre dans une plaquette que l'on achète en souvenir. Y compris
de très belles photographies de représentations que l'on ne voit
pas pendant la visite de la grotte. La mise en contexte est simple et
accessible aux non spécialistes (j'aurais bien aimé quand même
qu'il nous explique ce qu'est le « passage du Rubicon »
dans cette grotte : un zone plus étroite, et alors?). Il raconte la
découverte, décrit dans les grandes lignes la culture magdalénienne
pendant laquelle des hommes sont venus peindre et graver ici.
L'auteur reste toutefois excessivement
prudent quant aux interprétations possibles de cet « art
préhistorique ». Il évoque à deux ou trois reprises
« l'hypothèse chamanique », selon laquelle les peintres
et graveurs se contenteraient en certaines occasion de reconnaître
des animaux déjà présents dans le relief de la paroi. Mais il
n'explique pas clairement de quoi il s'agit (et pour cause, cette
hyptohèse est quand même assez fumeuse). Et il n'évoque aucune
autre hypothèse. Il remarque toutefois judicieusement que,
contrairement à ce que l'on dit et écrit souvent, la différence
entre le bestiaire représenté et la faune chassée n'est pas si
importante que cela.
Ce livre a le grand mérite d'exister,
et contentera la plupart des visiteurs, et des amateurs d'art
préhistorique. Mais une équipe de préhistoriens aurait-elle les
moyens de faire une nouvelle monographie sur cette grotte, fondée
sur des travaux récents? J'ai le sentiment que les questions de
conservation ont, ces dernières années, pris le pas sur l'étude
des œuvres (et de la façon dont elles fonctionnent ensemble).
jeudi 14 mai 2015
Istanbul
Je ne suis pas qualifié pour parler de littérature, et ce n'est pas le sujet de ce blog. Pourquoi alors mentionner ici que je viens de terminer la lecture d'Istanbul - Souvenirs d'une ville d'Orhan Pamuk? Le moins que l'on puisse dire est que l'auteur n'y parle pas de science. Cela m'a frappé. Durant toute son enfance et son adolescence, il ne semble pas avoir jamais levé les yeux pour apercevoir quelques étoiles. Et même la médecine est totalement absente des souvenirs qu'il évoque.
Le touriste qui visiterait aujourd'hui Istanbul pourrait tenter de suivre Pamuk dans ses pérégrinations à travers les quartiers de la ville, qui ne sont pas forcément ceux que l'on visite en premier. Très modestement (je n'ai séjourné qu'une dizaine de jours à Istanbul), je suggèrerais aussi à l'amateur de science de se rendre au Musée des sciences et des techniques en Islam. Ouvert en 2008 dans le parc de Gülhane (situé en contrebas du palais de Topkapi, incontournable), il est peu fréquenté si j'en crois mon expérience. Il vaut quand même un petit arrêt, quand on se rend du quartier historique de Sultanahmet vers les embarcadères le long de la Corne d'or. L'astronomie s'y taille la plus belle part, mais la physique, la chimie ou la minéralogie ne sont pas absentes. L'Empire ottoman n'était pas en reste vis-à-vis de l'Europe pour ce qui s'agissait de science, jusqu'au XVIIIe siècle au moins. Et les francophones sont bien accueillis, puisque les notices sont également rédigées dans notre langue.
Le touriste qui visiterait aujourd'hui Istanbul pourrait tenter de suivre Pamuk dans ses pérégrinations à travers les quartiers de la ville, qui ne sont pas forcément ceux que l'on visite en premier. Très modestement (je n'ai séjourné qu'une dizaine de jours à Istanbul), je suggèrerais aussi à l'amateur de science de se rendre au Musée des sciences et des techniques en Islam. Ouvert en 2008 dans le parc de Gülhane (situé en contrebas du palais de Topkapi, incontournable), il est peu fréquenté si j'en crois mon expérience. Il vaut quand même un petit arrêt, quand on se rend du quartier historique de Sultanahmet vers les embarcadères le long de la Corne d'or. L'astronomie s'y taille la plus belle part, mais la physique, la chimie ou la minéralogie ne sont pas absentes. L'Empire ottoman n'était pas en reste vis-à-vis de l'Europe pour ce qui s'agissait de science, jusqu'au XVIIIe siècle au moins. Et les francophones sont bien accueillis, puisque les notices sont également rédigées dans notre langue.
jeudi 30 avril 2015
Chamane et art rupestre
« Un être fantastique
apparaissait sur un pendant rocheux isolé de la voûte, en face du
grand panneau des lions. La tête et le poitrail étaient ceux d'un
bison, curieusement dressé, mais les membres antérieurs manquaient.
Quant aux membres postérieurs, c'étaient des jambes humaines,
robustes et massives. »
Cette description figure à la page 54
du Chamane du bout du monde du
préhistorien Jean Courtin (Seuil, 1998 ; réédité en poche en 1999). Le couple de héros
est, à ce moment du roman, dans la
grotte sacrée du clan de la panthère, plus communément nommée
aujourd'hui grotte de Vallon-Pont-d'Arc, dite grotte Chauvet.
L'auteur, comme nombre de scientifiques qui se sont essayés à la
littérature, s'emploie à être pédagogue. En l'occurrence, il nous
fait visiter le site, tout juste découvert alors qu'il écrit.
Par une coïncidence étonnante, une
description quasi identique figure en légende d'une photographie
dans le numéro de mai 2015 de La Recherche. L'image illustre un
article de Carole Fritz et Gilles Tosello, deux des préhistoriens
qui étudient les peintures de cette grotte. Malheureusement, ce qui
pouvait passer, à la fin des années 1990, pour une interprétation
littéraire de peintures rupestres à peine entrevues, est devenu
aujourd'hui une grossière erreur.
C'est ce que m'expliquait la semaine
dernière au téléphone Gilles Tosello. Je n'ai pu que déplorer
avec lui le fait qu'on ne lui ait pas soumis les légendes de l'article
avant que les fichiers ne partent chez l'imprimeur. Mon rôle dans
cette affaire s'était limité à solliciter les articles (depuis plus
d'un an, je suis opiniâtre) et à les transmettre à la nouvelle
équipe de rédaction, que j'ai quittée il y a bientôt deux mois
(bien que mon nom, à mon grand étonnement encore, figure dans le
magazine comme « ayant préparé ce dossier »).
La légende, comme la photographie, est
signée par Jean Clottes, premier préhistorien qui a pénétré dans
la grotte. Et date sans doute de la fin des années 1990. Dans le
contexte de l'époque, qu'illustre parfaitement le récit de Jean
Courtin, il était naturellement enclin à voir sur les parois des
représentations mêlant homme et animal : des chamanes, possédés
par des esprits au cours de transes produites par la prise de
substances psychotropes. L'étude des peintures entreprise depuis, et
l'examen de photographies prises sous d'autres angles (les
préhistoriens ne peuvent pas s'approcher de ce pendant, ni le
contourner, pour des raisons de préservation de la roche ; ils
doivent placer un appareil photographique au bout d'un mât pour
observer les autres faces) a montré que, sur ce pendant rocheux de
la grotte Chauvet, les figures sont bien séparées.
Le roman de Jean Courtin n'est pas si
mauvais qu'on me l'avait dit (opinion qui avait retardé ma lecture
jusqu'à aujourd'hui). L'intrigue suit un couple de héros bannis de
leur tribu ardéchoise dans leur descente du Rhône, de la grotte
Chauvet à la grotte Cosquer. Jean Courtin connaît bien cette
dernière pour l'avoir explorée dans les années 1990, sous la
direction de Jean Clottes (l'entrée est aujourd'hui sous le niveau
de la mer, et y accéder nécessite une bonne maîtrise de la plongée
sous-marine). Depuis La Guerre du feu, les romans
préhistoriques sont bien souvent des romans de quête.
Dans un souci pédagogique, l'auteur,
n'oubliant pas qu'il est préhistorien, décrit assez précisément
les comportements matériels des hommes et des femmes du
Paléolithique : types d'outils, modes de production, chasse,
conservation de la viande, etc. Le roman se prête bien à ce type de
reconstitution : les connaissances rigoureusement scientifiques sur
ces questions sont somme toute très limitées. L'auteur doit en
revanche complètement inventer pour ce qui concerne l'organisation
sociale, les relations entre groupes, les rôles des femmes et des
hommes.
Quant au chamanisme, et à ses
éventuelles relations avec les peintures rupestres, il est bien
dommage qu'il ait ainsi fait son chemin dans l'imagination du grand
public (journalistes de La Recherche compris). Lorsque Jean
Clottes a tenté, au milieu des années 1990, d'importer dans le
Paléolithique européen les concepts développés pour l'art
rupestre sud-africain par David Lewis-Williams, il a rencontré un
tir de barrage de ses collègues préhistoriens. De nombreuses études
critiques ont montré l'inanité de ces thèses. Certaines ont même
montré que Lewis-Williams n'avait sans doute pas compris grand chose
à l'art rupestre sud-africain lui-même. Dessiner un bison sur une
paroi sous l'effet d'une drogue quelconque, comme le décrit Jean
Courtin à la fin de son roman, est sans doute spectaculaire, mais il
y a peu de chances que cela se soit produit.
jeudi 16 avril 2015
Origine de l'art
La presse a beaucoup parlé la semaines dernière de l'inauguration de la Caverne du Pont d'Arc par François Hollande. J'y étais allé en février, et je confirme que ce sera une visite à faire et à refaire dans les prochaines années. Mais il n'est peut-être pas utile de s'y précipiter dès le 25 avril, date de l'ouverture au public. On peut lire un peu en attendant.
Poursuivant ma "tentative d'épuisement d'une bibliothèque parisienne" j'ai donc sorti Le chaman du bout du monde, roman préhistorique publié en 1998 par Jean Courtin. Oui, j'avoue, je ne l'ai pas lu. C'est au programme pour les prochains jours, et je vous en parlerai bientôt.
Pas très loin, j'avais rangé Préhistoires, de Jean Rouaud (Gallimard, 2007). Ce petit livre, disponible aujourd'hui en Folio à 2€ (cela ne vaut vraiment pas la peine de s'en priver) rassemble trois textes de l'auteur. En particulier, il contient le merveilleux Paléocircus, initialement publié aux éditions Flohic (aujourd'hui disparues).
Le Paléocircus raconte la naissance de l'art rupestre pendant la préhistoire, dans la grotte de Lascaux. C'est évidemment totalement anachronique. Jean Rouaud ne prétend pas faire oeuvre de préhistorien. Mais, inspiré par les peintures de la grotte périgourdine, il nous livre un petit récit très drôle, et à méditer avant de visiter une grotte ornée et d'écouter les théories que les guides seraient susceptibles de nous livrer.
Deux autres textes "préhistoriques" complètent le recueil : La caverne fantôme, aussi sur les peintres magdaléniens et Le manège de Carnac, paru précédemment au Seuil sous le titre Carnac ou le prince des lignes. Deux autres plaisirs de lecture.
Poursuivant ma "tentative d'épuisement d'une bibliothèque parisienne" j'ai donc sorti Le chaman du bout du monde, roman préhistorique publié en 1998 par Jean Courtin. Oui, j'avoue, je ne l'ai pas lu. C'est au programme pour les prochains jours, et je vous en parlerai bientôt.
Pas très loin, j'avais rangé Préhistoires, de Jean Rouaud (Gallimard, 2007). Ce petit livre, disponible aujourd'hui en Folio à 2€ (cela ne vaut vraiment pas la peine de s'en priver) rassemble trois textes de l'auteur. En particulier, il contient le merveilleux Paléocircus, initialement publié aux éditions Flohic (aujourd'hui disparues).
Le Paléocircus raconte la naissance de l'art rupestre pendant la préhistoire, dans la grotte de Lascaux. C'est évidemment totalement anachronique. Jean Rouaud ne prétend pas faire oeuvre de préhistorien. Mais, inspiré par les peintures de la grotte périgourdine, il nous livre un petit récit très drôle, et à méditer avant de visiter une grotte ornée et d'écouter les théories que les guides seraient susceptibles de nous livrer.
Deux autres textes "préhistoriques" complètent le recueil : La caverne fantôme, aussi sur les peintres magdaléniens et Le manège de Carnac, paru précédemment au Seuil sous le titre Carnac ou le prince des lignes. Deux autres plaisirs de lecture.
mercredi 15 avril 2015
Chassez le naturel...
Il y a quelques mois, j'ai animé au Laboratoire des sciences archéologiques de Bordeaux une conférence du géographe Christian Grataloup (dont la notice Wikipedia est fiable, m'a-t-il dit, car elle est tenue à jour par ses propres enfants!). Je l'avais rencontré pour préparer, et il m'avait à cette occasion offert L'invention des continents, qu'il avait publié chez Larousse en 2009. J'avais alors seulement parcouru rapidement ce livre, faute de temps. C'est seulement en le lisant la semaine dernière que j'ai eu la surprise de découvrir que l'auteur avait utilisé l'une de mes productions dans son argumentation.
En mai 2008, La Recherche, dont j'étais alors rédacteur en chef adjoint, avait titré en Une : "Il y a 1,8 million d'années, Homo erectus sort d'Afrique". Ce titre annonçait un dossier de paléoanthropologie contenant notamment un article de David Lordkipanidze sur les découvertes d'hominidés fossiles à Dmanisi, en Georgie, considérées comme les plus anciennes en Europe. Mais, souligne Christian Grataloup, un tel titre "supposait le continent africain comme une catégorie spatiale pertinente il y a 2 millions d'années" (page 26). "Pan sur le bec!", comme écrit un célèbre hebdomadaire satirique.
Si je mentionne cette anecdote, ce n'est pas seulement par narcissisme (ou par autodérision). C'est surtout parce qu'elle est significative du propos de Christian Grataloup dans cet ouvrage : une remise en question du concept si "naturel" de continent. Et s'appuyer pour cela sur l'histoire dudit concept. Des trois parties de l'Ancien Monde (Afrique, Asie et Europe), à l'ajout de l'Amérique (divisée ou non en deux selon les circonstances) et à la création improbable et paradoxale du "continent d'îles" que serait l'Océanie, comment le monde a-t-il été découpé et remodelé par nos ancêtres? Comment les nouvelles données de la science, telles celles de la tectonique des plaques, ont-elles été intégrées dans des schémas pré-existants, afin, bien souvent, de les conforter?
Le propos est érudit mais jamais ennuyeux. Et l'iconographie soutient parfaitement le texte, en présentant de nombreux documents mentionnés par ce dernier (même si la police utilisée pour les légendes est vraiment trop petite à mon goût). L'effort pour mettre l'argumentation à la portée du plus grand nombre me semble à la hauteur des enjeux. Avec le recul, six ans après la parution, j'espère que l'éditeur ne regrette pas son choix en examinant les chiffres des ventes. Ceux qui ont un intérêt pour les sciences historiques le liront en tous cas avec profit.
Quant à l'utilisation de l'adjectif "européen" pour qualifier l'Homo erectus ergaster georgicus de Dmanisi, le Neandertal d'il y a 200 000 ans, ou encore les cultures magdalénienne ou campaniforme, la presse l'évitera difficilement : il faut bien accrocher le lecteur qui se reconnaît, lui-même, européen. Peut-être les scientifiques, en revanche, devraient-ils y réfléchir à deux fois (d'autant que dans le cas de Dmanisi, la situation européenne est plus que discutable).
En mai 2008, La Recherche, dont j'étais alors rédacteur en chef adjoint, avait titré en Une : "Il y a 1,8 million d'années, Homo erectus sort d'Afrique". Ce titre annonçait un dossier de paléoanthropologie contenant notamment un article de David Lordkipanidze sur les découvertes d'hominidés fossiles à Dmanisi, en Georgie, considérées comme les plus anciennes en Europe. Mais, souligne Christian Grataloup, un tel titre "supposait le continent africain comme une catégorie spatiale pertinente il y a 2 millions d'années" (page 26). "Pan sur le bec!", comme écrit un célèbre hebdomadaire satirique.
Si je mentionne cette anecdote, ce n'est pas seulement par narcissisme (ou par autodérision). C'est surtout parce qu'elle est significative du propos de Christian Grataloup dans cet ouvrage : une remise en question du concept si "naturel" de continent. Et s'appuyer pour cela sur l'histoire dudit concept. Des trois parties de l'Ancien Monde (Afrique, Asie et Europe), à l'ajout de l'Amérique (divisée ou non en deux selon les circonstances) et à la création improbable et paradoxale du "continent d'îles" que serait l'Océanie, comment le monde a-t-il été découpé et remodelé par nos ancêtres? Comment les nouvelles données de la science, telles celles de la tectonique des plaques, ont-elles été intégrées dans des schémas pré-existants, afin, bien souvent, de les conforter?
Le propos est érudit mais jamais ennuyeux. Et l'iconographie soutient parfaitement le texte, en présentant de nombreux documents mentionnés par ce dernier (même si la police utilisée pour les légendes est vraiment trop petite à mon goût). L'effort pour mettre l'argumentation à la portée du plus grand nombre me semble à la hauteur des enjeux. Avec le recul, six ans après la parution, j'espère que l'éditeur ne regrette pas son choix en examinant les chiffres des ventes. Ceux qui ont un intérêt pour les sciences historiques le liront en tous cas avec profit.
Quant à l'utilisation de l'adjectif "européen" pour qualifier l'Homo erectus ergaster georgicus de Dmanisi, le Neandertal d'il y a 200 000 ans, ou encore les cultures magdalénienne ou campaniforme, la presse l'évitera difficilement : il faut bien accrocher le lecteur qui se reconnaît, lui-même, européen. Peut-être les scientifiques, en revanche, devraient-ils y réfléchir à deux fois (d'autant que dans le cas de Dmanisi, la situation européenne est plus que discutable).
dimanche 5 avril 2015
1001 grammes
Faire un film dont l'intrigue tourne autour de l'archaïque définition du kilogramme, c'est l'idée originale qu'a eue le réalisateur norvégien Bent Hamer. Malheureusement, il est à craindre que la piètre qualité du résultat ne permettra pas de populariser la passionnante question de l'unité de masse.
Le kilogramme, unité internationale de masse, est unique. C'est la seule unité de mesure pour laquelle il existe encore un étalon : un cylindre de platine et d'iridium. Celui-ci est conservé au siège du Bureau international des poids et mesures, au Pavillon de Breteuil, dans le Parc de Saint-Cloud. Il soigneusement entreposé, sous trois cloches de verre, dans un coffre fort, à l'abri des rayons cosmiques, dont l'absorption pourrait, au fil du temps, augmenter un peu sa masse.
Il existe toutefois des copies. Des références sont conservées au même endroit et dans les mêmes conditions; elles sont utilisées pour étalonner les kilogrammes étalons des différents pays signataires de la convention internationale des poids et mesures. Malheureusement, malgré toutes les précautions, les masses de toutes ces copies varient légèrement les unes par rapport eux autres, et par rapport à l'étalon princeps.
Les spécialistes ont donc imaginé de remplacer cet étalon par "autre chose". Le mètre ou la seconde sont définis par rapport à des fréquences lumineuses particulières, et peuvent donc être mesurés n'importe où dans le monde, à condition de disposer du matériel adéquat. Quelle quantité pourrait-on mesurer pour obtenir un kilogramme?
L'une des pistes, suivie par le "projet Avogadro", est de fixer une fois pour toute la valeur de la constante d'Avogadro, l'unité de mole, définie comme le nombre exact d'atomes contenus dans 12 grammes de carbone 12. Le kilogramme serait alors défini par le douzième de la constante d'Avogradro, multiplié par 1 000. Les travaux portent sur la mesure la plus précise possible de cette constante dans le système actuel d'unités. Cela reviendrait à faire ce qui a été fait pour la vitesse de la lumière, dont la valeur a été fixée une fois pour toute, et permet d'étalonner le temps et la distance.
Une autre piste est une mesure de force électromagnétique (donc de courant électrique) nécessaire pour maintenir en l'air une certaine masse. De nombreux travaux sont en cours pour améliorer la cohérence des mesures électriques. Le kilogramme serait alors défini à partir de l'Ampère et du Volt.
On le voit, le sujet, bien qu'il ne concerne directement qu'un nombre réduit de physiciens, est excitant; C'est aussi une source de bonnes histoires scientifiques. Bent Hamer en évoque certains aspects dans son film, dont une partie de l'action est située au pavillon de Breteuil, pendant une conférence internationale portant, justement, sur la définition du kilogramme. Chaque délégué a aussi apporté le kilogramme étalon de son pays, afin de le faire vérifier. Cela donne lieu à quelques scènes processionnaires assez drôles.
On a toutefois du mal à s'intéresser vraiment à la relation entre la déléguée norvégienne, qui a remplacé au pied levé son père victime d'un accident cardiaque, et un jardinier-physicien, totalement improbable. La métaphore de la masse que transporte cette femme et du poids de sa vie est, excusez, un peu lourde. On tombe dans le gnan-gnan.
J'ai rêvé à ce que Bruno Podalydès aurait pu faire avec un tel scénario. Quitte à garder l'actrice norvégienne et à remplacer Laurent Stocker (bien qu'il ne démérite pas) par son confère du Français, Denis Podalydès. On y pense d'autant plus lorsque les héros enregistrent des sons dans la nature (souvenir de Dieu seul me voit?). Bref, un occasion manquée pour la physique, un visionnage évitable pour le cinéma.
Le kilogramme, unité internationale de masse, est unique. C'est la seule unité de mesure pour laquelle il existe encore un étalon : un cylindre de platine et d'iridium. Celui-ci est conservé au siège du Bureau international des poids et mesures, au Pavillon de Breteuil, dans le Parc de Saint-Cloud. Il soigneusement entreposé, sous trois cloches de verre, dans un coffre fort, à l'abri des rayons cosmiques, dont l'absorption pourrait, au fil du temps, augmenter un peu sa masse.
Il existe toutefois des copies. Des références sont conservées au même endroit et dans les mêmes conditions; elles sont utilisées pour étalonner les kilogrammes étalons des différents pays signataires de la convention internationale des poids et mesures. Malheureusement, malgré toutes les précautions, les masses de toutes ces copies varient légèrement les unes par rapport eux autres, et par rapport à l'étalon princeps.
Les spécialistes ont donc imaginé de remplacer cet étalon par "autre chose". Le mètre ou la seconde sont définis par rapport à des fréquences lumineuses particulières, et peuvent donc être mesurés n'importe où dans le monde, à condition de disposer du matériel adéquat. Quelle quantité pourrait-on mesurer pour obtenir un kilogramme?
L'une des pistes, suivie par le "projet Avogadro", est de fixer une fois pour toute la valeur de la constante d'Avogadro, l'unité de mole, définie comme le nombre exact d'atomes contenus dans 12 grammes de carbone 12. Le kilogramme serait alors défini par le douzième de la constante d'Avogradro, multiplié par 1 000. Les travaux portent sur la mesure la plus précise possible de cette constante dans le système actuel d'unités. Cela reviendrait à faire ce qui a été fait pour la vitesse de la lumière, dont la valeur a été fixée une fois pour toute, et permet d'étalonner le temps et la distance.
Une autre piste est une mesure de force électromagnétique (donc de courant électrique) nécessaire pour maintenir en l'air une certaine masse. De nombreux travaux sont en cours pour améliorer la cohérence des mesures électriques. Le kilogramme serait alors défini à partir de l'Ampère et du Volt.
On le voit, le sujet, bien qu'il ne concerne directement qu'un nombre réduit de physiciens, est excitant; C'est aussi une source de bonnes histoires scientifiques. Bent Hamer en évoque certains aspects dans son film, dont une partie de l'action est située au pavillon de Breteuil, pendant une conférence internationale portant, justement, sur la définition du kilogramme. Chaque délégué a aussi apporté le kilogramme étalon de son pays, afin de le faire vérifier. Cela donne lieu à quelques scènes processionnaires assez drôles.
On a toutefois du mal à s'intéresser vraiment à la relation entre la déléguée norvégienne, qui a remplacé au pied levé son père victime d'un accident cardiaque, et un jardinier-physicien, totalement improbable. La métaphore de la masse que transporte cette femme et du poids de sa vie est, excusez, un peu lourde. On tombe dans le gnan-gnan.
J'ai rêvé à ce que Bruno Podalydès aurait pu faire avec un tel scénario. Quitte à garder l'actrice norvégienne et à remplacer Laurent Stocker (bien qu'il ne démérite pas) par son confère du Français, Denis Podalydès. On y pense d'autant plus lorsque les héros enregistrent des sons dans la nature (souvenir de Dieu seul me voit?). Bref, un occasion manquée pour la physique, un visionnage évitable pour le cinéma.
A la guerre comme à la guerre
"La guerre de Troie a-t-elle eu lieu?" interroge Stéphane Foucart, journaliste au Monde en titre de son plus récent livre, paru en octobre 2014 (La Librairie Vuibert, 128 p., 10,50 €). Il est constitué de l'assemblage d'une série d'articles publiés au cours de l'été 2014 dans le quotidien qui l'emploie (mais enrichis, je le crois sur parole, les formats journalistiques étant plus contraignants que ceux des livres). La question n'est pas neuve, mais le sujet a le potentiel pour intéresser à l'archéologie un public cultivé.
Dans l'Antiquité, déjà, la guerre de Troie était un récit ancien, à propos d'événements totalement oubliés par ailleurs. Composé au cours du VIIIe siècle avant notre ère, il narre des événements qui se seraient produits quatre à cinq siècles auparavant. Aussi les érudits antiques ont-ils déjà abondamment commenté ce texte.
Mais ce n'est qu'au XIXe siècle que des travaux scientifiques ont véritablement commencé à propos de Troie. On retrouve ici l'allemand Heinrich Schliemann, qui localisa la cité perdue et la fouilla dans les années 1870, en détruisant au passage une bonne partie. On découvre aussi, moins connus, les linguistes Milman Parry et Albert Lord qui, dans les années 1920 étudièrent les mécanismes de transmission et de reproduction des épopées guerrières traditionnelles. Plus récemment, dans les années 1980, l'archéologue allemand Manfred Korfmann fit progresser considérablement la connaissance du site et, surtout, des vestiges supposés contemporains des événements de l'Iliade, avec son équipe de l'université de Tübingen.
C'est tout cela, et bien d'autres choses, que Stéphane Foucart nous raconte dans un style enlevé. Faire de l'archéologie un livre à la main, la Bible en Terre Sainte, les Commentaires de César en Gaule, ou l'Iliade, donc, en Grèce et en Turquie, est toujours hasardeux. Qu'avaient vraiment en tête les rédacteurs de ces textes? Certainement pas de laisser à de lointains descendants la possibilité de retrouver les traces matérielles de faits réels.
Le souci de Stéphane Foucart de ne pas tromper son lecteur, et son application à tenter de répondre à la question qui lui sert de titre, le conduisent par moments à des positions périlleuses de ce point de vue. Que l'on retrouve les noms des héros de l'Iliade, plus ou moins déformés, dans des textes grecs ou hittites n'a finalement que peu d'importance. Toutefois, dans l'ensemble, il ne s'en sort pas si mal, et le sous-titre de l'ouvrage, "Enquête sur un mythe", n'est pas non plus usurpé.
A ceux qui souhaiteraient en apprendre un peu plus sur la guerre de Troie, je suggère en complément la lecture d'un ouvrage collectif, issu de conférences grand public (mais érudites) et publié en 2007 par les éditions InFolio : Le cheval de Troie - variations autour d'une guerre.
Dans l'Antiquité, déjà, la guerre de Troie était un récit ancien, à propos d'événements totalement oubliés par ailleurs. Composé au cours du VIIIe siècle avant notre ère, il narre des événements qui se seraient produits quatre à cinq siècles auparavant. Aussi les érudits antiques ont-ils déjà abondamment commenté ce texte.
Mais ce n'est qu'au XIXe siècle que des travaux scientifiques ont véritablement commencé à propos de Troie. On retrouve ici l'allemand Heinrich Schliemann, qui localisa la cité perdue et la fouilla dans les années 1870, en détruisant au passage une bonne partie. On découvre aussi, moins connus, les linguistes Milman Parry et Albert Lord qui, dans les années 1920 étudièrent les mécanismes de transmission et de reproduction des épopées guerrières traditionnelles. Plus récemment, dans les années 1980, l'archéologue allemand Manfred Korfmann fit progresser considérablement la connaissance du site et, surtout, des vestiges supposés contemporains des événements de l'Iliade, avec son équipe de l'université de Tübingen.
C'est tout cela, et bien d'autres choses, que Stéphane Foucart nous raconte dans un style enlevé. Faire de l'archéologie un livre à la main, la Bible en Terre Sainte, les Commentaires de César en Gaule, ou l'Iliade, donc, en Grèce et en Turquie, est toujours hasardeux. Qu'avaient vraiment en tête les rédacteurs de ces textes? Certainement pas de laisser à de lointains descendants la possibilité de retrouver les traces matérielles de faits réels.
Le souci de Stéphane Foucart de ne pas tromper son lecteur, et son application à tenter de répondre à la question qui lui sert de titre, le conduisent par moments à des positions périlleuses de ce point de vue. Que l'on retrouve les noms des héros de l'Iliade, plus ou moins déformés, dans des textes grecs ou hittites n'a finalement que peu d'importance. Toutefois, dans l'ensemble, il ne s'en sort pas si mal, et le sous-titre de l'ouvrage, "Enquête sur un mythe", n'est pas non plus usurpé.
A ceux qui souhaiteraient en apprendre un peu plus sur la guerre de Troie, je suggère en complément la lecture d'un ouvrage collectif, issu de conférences grand public (mais érudites) et publié en 2007 par les éditions InFolio : Le cheval de Troie - variations autour d'une guerre.
lundi 30 mars 2015
Quelques semaines avec Darwin
Plusieurs semaines se sont écoulées
depuis mon dernier billet sur ce blog. Je les ai consacrées à lire.
En particulier, à lire un gros livre, 543 pages sans les notes.
Dense. Et je ne chronique ici des livres qu'après les avoir lus.
Je viens donc de terminer Charles
Darwin – Voyaging, par Janet Browne (Princeton University
Press, 1996, 31,95$). Ce n'est pas un ouvrage récent. Sa première
édition a juste 20 ans. Mais c'est une référence en matière de
biographie du grand homme.
L'auteur connaît son sujet. Historienne de la biologie à Londres, elle a
participé à l'édition de la correspondance de Darwin. Elle est
aujourd'hui professeur à l'université Harvard, aux Etats-Unis. Et
l'on sent, à la lire, qu'elle a tout lu des écrits de Darwin :
articles scientifiques, notes, correspondances publique et privée. Et
même, dans de nombreux cas, lettres qu'il a reçues, lettres
échangées par ses proches ou par ses « collègues »
savants contemporains, textes de ces derniers à propos des sujets
qui intéressaient Darwin.
C'est donc une biographie en profondeur
qu'elle a écrite. On suit pas à pas Charles Darwin, de sa naissance
au début de 1856 dans ce volume (le second, intitulé The
Power of Place, traite de la deuxième partie de sa vie, de la
publication de sa théorie sur l'évolution des espèces par
sélection naturelle jusqu'à sa mort. Je n'en parlerai pas ici :
je l'ai lu il y a plusieurs années, alors que je préparais un
numéro des Dossiers de La Recherche produit à l'occasion du
150ème anniversaire de cette publication, et du bicentenaire de la
naissance de Darwin). Mais on fait aussi connaissance en profondeur
avec tous ceux qu'il a rencontré et qui l'ont influencé : les
divers membres de sa famille, ses professeurs, ses compagnons de
voyage à bord du Beagle, les autres savants de son entourage.
J'avais lu déjà des ouvrages sur
l'idée d'évolution avant Darwin. Je n'étais pas totalement ignare
non plus à propos de sa théorie de l'évolution, ni à propos de
son parcours. Mais la précision et l'exhaustivité de ce livre sont
irremplaçables pour connaître et comprendre Darwin.
Je ne vais pas ici raconter son
cheminement scientifique : Janet Browne (et bien d'autres) l'a
fait bien mieux que je ne saurais le résumer. Quelques points que
j'ignorais toutefois. Darwin a d'abord été reconnu comme géologue,
tenant de la théorie proposée par Charles Lyell selon laquelle la
surface de la Terre n'était pas immuable, mais au contraire se
transformait, par élévation ou enfoncement par rapport à la mer.
Il est devenu biologiste, notamment en menant une
étude très complète sur les Cirripèdes, groupe de crustacés,
car il voulait étayer sa théorie par des faits. Ce qu'il a
découvert chez les Cirripèdes l'a conforté, et a aussi fait
évoluer sa pensée : un remarquable exemple de science en
action.
L'autre aspect pour lequel ce livre est
remarquable est qu'il nous fait connaître aussi l'homme Darwin.
Janet Browne est en empathie avec son sujet. Et elle nous fait
partager cet état. On suit d'abord amusé le jeune homme de bonne
famille dans son adolescence, où il préférait aller à la chasse
avec son oncle ou ses amis qu'étudier à Cambridge. Et on est
bouleversé par ce père de famille qui se livre à l'affection de et
pour ses enfants. Jusqu'au drame que constitua la mort de sa fille
Anne à l'âge de 10 ans.
Cette lecture est exigeante. Je vais
sans doute passer maintenant à un ouvrage plus court et moins
érudit. Mais on ne peut que la recommander à tous ceux qui
s'intéressent, à Darwin, à la biologie, ou plus généralement à
l'histoire des sciences. Il n'a hélas pas été traduit en français.
C'est compréhensible : le risque éditorial aurait sans doute
été trop grand. Mais c'est dommage.
lundi 23 février 2015
The Imitation Game
Allez voir The Imitation Game au cinéma. Ou procurez-vous un DVD quand ça sortira. Et dans le second cas, prêtez-le à des amis.
D'accord, ce n'est pas le film de l'année (du moins j'espère, il y a encore beaucoup de choses à venir). D'accord, ce n'est pas une biographie très fidèle d'Alan Turing (voir à ce sujet la notice Wikipedia du film, qui fait état des controverses). D'accord, pour cela, il vaudrait sans doute mieux lire le livre dont le film est une adaptation. D'accord, ce blog est censé être consacré aux livres d'ailleurs.
Mais j'ai constaté dans mon proche entourage que Turing n'est pas très connu. Ce film est une occasion de populariser un important acteur de l'histoire des sciences. Mais Benedict Cumberbatch est l'acteur en activité qui a sans doute incarné le plus de personnages historiques dans des biographies (plus ou moins romancées). Mais le pardon accordé par la reine d'Angleterre à Turing n'empêche pas qu'il a été condamné en 1951 pour homosexualité. Mais, comme le rappelle le film, plusieurs dizaines de milliers d'homosexuels ont été condamnés au Royaume-Uni pour le seul fait d'être ce qu'ils étaient, et n'ont toujours pas été "pardonnés" (il me semble qu'en France on dirait réhabilités). Une pétition a d'ailleurs été lancée dans ce but à l'occasion de la sortie du film.
Je laisse les critiques cinématographiques aux spécialistes. Malgré quelques doutes initiaux (après notamment la lecture de critiques par des scientifiques), j'ai été pris par cette histoire. On suit Turing essentiellement pendant la Deuxième Guerre mondiale, tandis qu'il participait au décryptage des codes de transmissions allemands. Il y met au point l'un des tout premiers ordinateurs. Des flashbacks nous renvoient à sa pré-adolescence dans un collège anglais, et à la mort de son premier amour. D'autres séquences nous racontent la fin de sa vie : son arrestation après un cambriolage par l'un de ses amants, sa condamnation. Ces deux séries d'excursions temporelles permettent de situer pourquoi Turing est un personnage si dramatique : il était homosexuel dans un pays qui pénalisait l'homosexualité ; il était un héros de guerre sur un projet top secret, et n'a jamais été reconnu publiquement en tant que tel.
Certes, le réalisateur a ajouté une intrigue d'espionnage, en rajoute sur la clairvoyance de Turing quant à l'utilisation des messages allemands qu'il a décryptés, glisse un couplet féministe en insistant sur le rôle de Joan Clarke. Mais que Turing soit devenu un personnage de fiction, que des auteurs s'approprient et transforment à leur gré : n'est-ce pas le meilleure hommage que l'on puisse lui rendre? J'avais déjà critiqué un roman à son sujet fin 2013.
Et si vous n'êtes encore pas convaincus, voici la bande annonce.
D'accord, ce n'est pas le film de l'année (du moins j'espère, il y a encore beaucoup de choses à venir). D'accord, ce n'est pas une biographie très fidèle d'Alan Turing (voir à ce sujet la notice Wikipedia du film, qui fait état des controverses). D'accord, pour cela, il vaudrait sans doute mieux lire le livre dont le film est une adaptation. D'accord, ce blog est censé être consacré aux livres d'ailleurs.
Mais j'ai constaté dans mon proche entourage que Turing n'est pas très connu. Ce film est une occasion de populariser un important acteur de l'histoire des sciences. Mais Benedict Cumberbatch est l'acteur en activité qui a sans doute incarné le plus de personnages historiques dans des biographies (plus ou moins romancées). Mais le pardon accordé par la reine d'Angleterre à Turing n'empêche pas qu'il a été condamné en 1951 pour homosexualité. Mais, comme le rappelle le film, plusieurs dizaines de milliers d'homosexuels ont été condamnés au Royaume-Uni pour le seul fait d'être ce qu'ils étaient, et n'ont toujours pas été "pardonnés" (il me semble qu'en France on dirait réhabilités). Une pétition a d'ailleurs été lancée dans ce but à l'occasion de la sortie du film.
Je laisse les critiques cinématographiques aux spécialistes. Malgré quelques doutes initiaux (après notamment la lecture de critiques par des scientifiques), j'ai été pris par cette histoire. On suit Turing essentiellement pendant la Deuxième Guerre mondiale, tandis qu'il participait au décryptage des codes de transmissions allemands. Il y met au point l'un des tout premiers ordinateurs. Des flashbacks nous renvoient à sa pré-adolescence dans un collège anglais, et à la mort de son premier amour. D'autres séquences nous racontent la fin de sa vie : son arrestation après un cambriolage par l'un de ses amants, sa condamnation. Ces deux séries d'excursions temporelles permettent de situer pourquoi Turing est un personnage si dramatique : il était homosexuel dans un pays qui pénalisait l'homosexualité ; il était un héros de guerre sur un projet top secret, et n'a jamais été reconnu publiquement en tant que tel.
Certes, le réalisateur a ajouté une intrigue d'espionnage, en rajoute sur la clairvoyance de Turing quant à l'utilisation des messages allemands qu'il a décryptés, glisse un couplet féministe en insistant sur le rôle de Joan Clarke. Mais que Turing soit devenu un personnage de fiction, que des auteurs s'approprient et transforment à leur gré : n'est-ce pas le meilleure hommage que l'on puisse lui rendre? J'avais déjà critiqué un roman à son sujet fin 2013.
Et si vous n'êtes encore pas convaincus, voici la bande annonce.
samedi 21 février 2015
Errements à l'Académie des sciences
En juillet 1867, le très honorable
mathématicien Michel Chasles, membre de l'Académie des sciences,
communiqua à celle-ci des informations extraordinaires. Il avait en
sa possession des lettres autographes de Blaise Pascal et d'Isaac
Newton prouvant qu'ils avaient échangé une correspondance. Et que
c'est le premier qui avait établi la loi de l'attraction des corps
dont le second avait revendiqué la paternité.
Le fait que cette correspondance ait
commencé alors que le jeune Newton n'était âgé que de 11 ans
n'alerta pas les savants. Il faut dire que des lettres d'autres
personnages illustres de l'époque corroboraient les faits : La
Bruyère, Robert Boyle, Montesquieu, Leibniz, etc.
Le scandale s'amplifia quand d'autre
lettre révélèrent que Pascal tenait lui-même ses connaissances de
lettres échangées plusieurs décennies plus tôt avec Galilée
lui-même! Et que ce dernier avait été victime de l'indélicatesse
de l'astronome Christian Huygens à propos de la découverte de
satellites de Saturne.
Indignés, des scientifiques
britanniques crièrent à la mystification. Mais Chasles tint bon,
produisant toujours plus de lettres (il affirma en posséder 2 000 de
la main de Galilée). L'affaire dura deux ans.
Le fait que tout ce beau monde écrivit
en français perturbait tout de même quelques académiciens.
Certains convainquirent Chasles de faire photographier des lettres de
Galilée et de les envoyer en Italie pour comparaison. D'autres
érudits montrèrent que plusieurs lettres plagiaient des livres
postérieurs à leur date supposée.
Mais le mathématicien ne reconnu son
"erreur" qu'après l'arrestation, sur sa plainte, d'un
individu nommé Vrain Lucas. Ce dernier avait en effet omis de lui
livrer les 3 000 autographes qu'il lui avait promis en échange d'une
somme d'argent déjà encaissée. Lucas était l'auteur de toutes ces
lettres, que l'on reconnaît aujourd'hui comme des faux grossiers.
J'avais déjà entendu raconter
l'aveuglement de Chasles. J'ignorais qu'il avait aussi gagné quelque
temps d'autres éminents savants. C'est l'un des mérites du livre de
Gérard Coulon "Signé Vrain Lucas" (Errance, 2015, 192 p.,
23€) de nous rapporter l'histoire en détails. Son enquête, qui ne contient que des faits déjà connus, ne s'arrête toutefois pas là. Il a reconstitué la vie du
faussaire, et tenté de cerner ses motivations.
Comment cet autodidacte originaire
d'une famille plus que modeste de Chateaudun, en Eure-et-Loir, en
est-il venu à duper l'un des savants français les plus respectés?
A écrire (et à vendre) des lettres signées par Vercingétorix,
Thalès, Socrate, Cléopâtre et même Jésus? Plus c'est gros, plus
ça passe, pourrait être une morale de ce récit. Reste que l'on
s'interroge sur la psychologie de Chasles, et sur celle de ses
confrères académiciens, qui n'hésitèrent pas à continuer de lui
confier des responsabilités au sein de l'institution, malgré le
ridicule dont il s'était couvert.
Inscription à :
Articles (Atom)